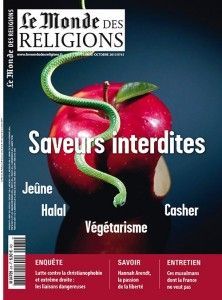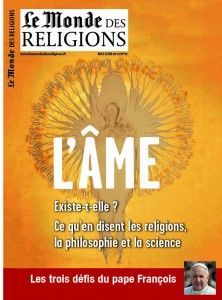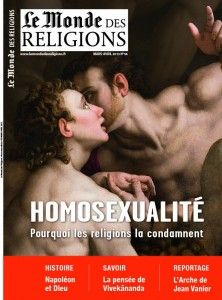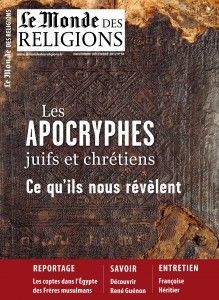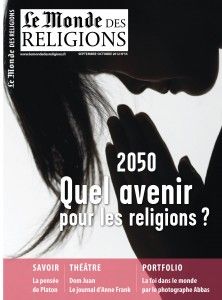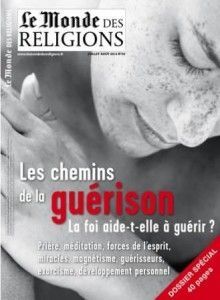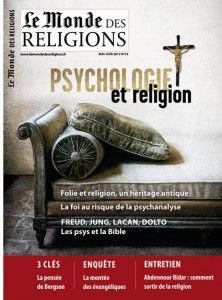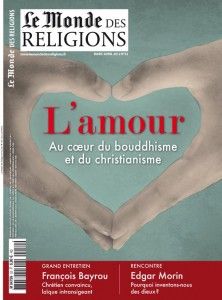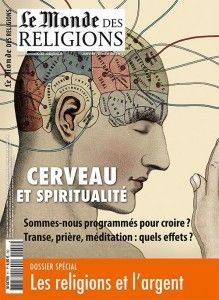Editos Monde des religions
Classement par ordre chronologique décroissant : du plus récent (nov-déc 2013) au plus ancien (nov-déc 2004)
Enregistrer
Enregistrer
Le Monde des Religions n° 62 – Nov/Décembre 2013 –
Sur la question des miracles, je ne connais aucun texte aussi profond et éclairant que la réflexion que nous livre Spinoza dans le chapitre 6 du Traité théologico-politique. « De même que les hommes appellent divine toute science qui surpasse la portée de l’esprit humain, ils voient la main de Dieu dans tout phénomène dont la cause est généralement ignorée », écrit le philosophe hollandais. Or, Dieu ne saurait agir en dehors des lois de la nature qu’il a lui-même établies. S’il existe des phénomènes inexpliqués, ceux-ci ne contrecarrent jamais les lois naturelles, mais ils nous apparaissent comme « miraculeux » ou « prodigieux » parce que nous avons une connaissance encore limitée des lois complexes de la nature. Spinoza explique ainsi que les prodiges rapportés dans les Écritures sont soit légendaires, soit le fait de causalités naturelles qui dépassent notre entendement : il en va ainsi de la mer Rouge qui se serait ouverte sous l’effet d’un vent violent, ou des guérisons de Jésus qui mobiliseraient des ressources encore ignorées du corps ou de l’esprit humain. Le philosophe se livre ensuite à une déconstruction politique de la croyance aux miracles et dénonce l’« arrogance » de ceux qui entendent ainsi montrer que leur religion ou leur nation « est plus chère à Dieu que toutes les autres ». Non seulement la croyance aux miracles, entendus comme phénomènes surnaturels, lui apparaît comme une « stupidité » contraire à la raison, mais aussi contraire à la foi véritable, et qui la desservirait : « Si donc un phénomène se produisait dans la nature qui ne fût point conforme à ses lois, on devrait admettre de toute nécessité qu’il leur est contraire et qu’il renverse l’ordre que Dieu a établi dans l’univers en lui donnant des lois générales pour le régler éternellement. D’où il faut conclure que la croyance aux miracles devrait conduire au doute universel et à l’athéisme. »
Ce n’est pas sans émotion que j’écris cet éditorial, car c’est le dernier. Cela fait en effet bientôt dix ans que je dirige Le Monde des Religions. Le temps est venu de passer la main et de consacrer tout mon temps à mes projets personnels : livres, pièces de théâtre et bientôt, je l’espère, film de cinéma. J’ai eu beaucoup de joie à vivre cette aventure éditoriale exceptionnelle et vous remercie du fond du cœur pour votre fidélité, qui a permis à ce journal de devenir une véritable référence sur le fait religieux dans toute la francophonie (il est diffusé dans seize pays francophones). Je souhaite vivement que vous continuiez à lui rester attachés et je suis heureux d’en confier les rênes à Virginie Larousse, la rédactrice en chef, qui a une excellente connaissance des religions et une bonne expérience journalistique. Elle sera aidée dans sa tâche par un comité éditorial rassemblant plusieurs personnalités qui vous sont familières. Nous travaillons ensemble à une nouvelle formule que vous découvrirez en janvier, et qu’elle vous présentera elle-même dans le prochain numéro.
Très belle continuation à toutes et à tous.Lire les articles en ligne du Monde des Religions : www.lemondedesreligions.fr
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer [...]
Le Monde des Religions n° 61 – Sept/Octobre 2013 –Comme l’écrivait Saint Augustin dans La Vie heureuse : « Le désir de bonheur est essentiel à l’homme ; il est le mobile de tous nos actes. La chose au monde la plus vénérable, la plus entendue, la plus éclaircie, la plus constante, c’est non seulement qu’on veut être heureux mais qu’on ne veut être que cela. C’est à quoi nous force notre nature. » Si chaque être humain aspire au bonheur, toute la question est de savoir si un bonheur profond et durable peut exister ici-bas. Les religions apportent à ce sujet des réponses très divergentes. Les deux positions les plus opposées me semblent être celles du bouddhisme et du christianisme. Tandis que toute la doctrine du Bouddha repose sur la poursuite d’un état de parfaite sérénité ici et maintenant, celle du Christ promet aux fidèles le vrai bonheur dans l’au-delà. Cela tient à la vie de son fondateur – Jésus meurt vers 36 ans de manière tragique – mais aussi à son message : le Royaume de Dieu qu’il annonce n’est pas un royaume terrestre mais céleste et la béatitude est à venir : « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés » (Matthieu, 5, 5).
Dans un monde antique plutôt enclin à rechercher le bonheur ici et maintenant, y compris dans le judaïsme, Jésus déplace clairement la problématique du bonheur vers l’au-delà. Cette espérance du paradis céleste va traverser l’histoire de l’Occident chrétien et conduire parfois à bien des extrémismes : ascétisme radical et souhait du martyr, mortifications et souffrances recherchées en vue du Royaume céleste. Mais avec le fameux mot de Voltaire – « Le paradis est où je suis » – s’opère en Europe à partir du XVIIIe siècle un formidable renversement de perspective : le paradis ne doit plus être attendu dans l’au-delà mais réalisé sur Terre, grâce à la raison et aux efforts des hommes. La croyance dans l’au-delà – et donc dans un paradis au ciel – va progressivement s’amenuiser et la grande majorité de nos contemporains vont se mettre en quête d’un bonheur ici et maintenant. La prédication chrétienne en est totalement bouleversée. Après avoir tant insisté sur les tourments de l’enfer et les joies du paradis, les prédicateurs catholiques et protestants ne parlent presque plus de l’au-delà.
Les courants chrétiens qui ont le plus le vent en poupe – les évangéliques et les charismatiques – ont parfaitement intégré cette nouvelle donne et ne cessent d’affirmer que la foi en Jésus procure le plus grand des bonheurs, dès ici-bas. Et puisque nombre de nos contemporains assimilent bonheur et richesse, certains vont même jusqu’à promettre aux fidèles la « prospérité économique » sur Terre, grâce à la foi. On est très loin de Jésus qui affirmait qu’« il est plus facile pour un chameau de rentrer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le Royaume des cieux » (Matthieu, 19, 24) ! La vérité profonde du christianisme se trouve sans doute entre ces deux extrémités : le refus de la vie et l’ascétisme morbide – justement dénoncé par Nietzsche – au nom de la vie éternelle ou de la peur de l’enfer d’un côté ; la seule poursuite du bonheur terrestre de l’autre. Jésus, au fond, n’a pas méprisé les plaisirs de cette vie et n’a pratiqué aucune « mortification » : il aimait boire, manger, partager avec ses amis. On le voit souvent « tressaillir de joie ». Mais il a clairement affirmé que la béatitude suprême n’est pas à attendre en cette vie. Il ne récuse pas le bonheur terrestre, mais fait passer d’autres valeurs avant lui : l’amour, la justice, la vérité. Il montre ainsi qu’on peut sacrifier son bonheur ici-bas et donner sa vie par amour, pour lutter contre l’injustice ou pour être fidèle à une vérité. Les témoignages contemporains de Gandhi, de Martin Luther King ou de Nelson Mandela en sont de belles illustrations. Reste à savoir si le don de leur vie trouvera une juste récompense dans l’au-delà ? C’est la promesse du Christ et l’espérance de milliards de croyants à travers le monde.Lire les articles en ligne du Monde des Religions : www.lemondedesreligions.fr [...]
Le Monde des Religions n° 60 – Juillet/Août 2013 –Une histoire juive raconte qu’en réalité, Dieu a créé Ève avant Adam. Comme Ève s’ennuie au paradis, elle demande à Dieu de lui donner un compagnon. Après mûre réflexion, Dieu finit par accéder à sa demande : « Entendu, je vais créer l’homme. Mais fais attention, il est très susceptible : ne lui dis jamais que tu as été créée avant lui, il le prendrait très mal. Que cela reste un secret entre nous… entre femmes ! »
Si Dieu existe, il est bien évident qu’il n’est pas sexué. On peut donc se demander pourquoi la plupart des grandes religions s’en sont faites une représentation exclusivement masculine. Comme le rappelle le dossier de ce numéro, il n’en a pas toujours été ainsi. Le culte de la Grande Déesse a sans doute précédé celui de « Yahvé, seigneur des armées », et les déesses occupaient une place de choix dans les panthéons des premières civilisations. La masculinisation du clergé est sans doute l’une des principales raisons de ce renversement, qui s’opéra au cours des trois millénaires qui précèdent notre ère : comment une cité et une religion gouvernées par des hommes pouvaient-elles vénérer une divinité suprême du sexe opposé ? Avec le développement des sociétés patriarcales, la cause est donc entendue : le dieu suprême, ou le dieu unique, ne peut plus être conçu comme féminin. Non seulement dans sa représentation, mais aussi dans son caractère et sa fonction : on valorise ses attributs de puissance, de domination, de pouvoir. Au ciel comme sur la terre, le monde est gouverné par un mâle dominateur.
Même si le caractère féminin du divin va subsister au sein des religions à travers divers courants mystiques ou ésotériques, ce n’est finalement qu’à l’époque moderne que cette hypermasculinisation de Dieu est véritablement remise en cause. Non qu’on passerait d’une représentation masculine à une représentation féminine du divin. Nous assistons plutôt à un rééquilibrage. Dieu n’est plus essentiellement perçu comme un juge redoutable, mais surtout comme bon et miséricordieux ; les croyants sont de plus en plus nombreux à croire en sa bienveillante providence. On pourrait dire que la figure typiquement « paternelle » de Dieu tend à s’estomper au profit d’une représentation plus typiquement « maternelle ». De même la sensibilité, l’émotion, la fragilité, sont valorisées dans l’expérience spirituelle. Cette évolution n’est évidemment pas sans lien avec la revalorisation de la femme dans nos sociétés modernes qui touche de plus en plus les religions, en permettant notamment à des femmes d’accéder à des fonctions d’enseignement et de direction du culte. Elle traduit aussi la reconnaissance, dans nos sociétés modernes, de qualités et de valeurs identifiées comme plus « typiquement » féminines, même si elles concernent évidemment tout autant les hommes que les femmes : la compassion, l’ouverture, l’accueil, la protection de la vie. Face à l’inquiétant sursaut machiste des intégrismes religieux de tous bords, je suis convaincu que cette revalorisation de la femme et cette féminisation du divin constituent la clé principale d’un véritable renouveau spirituel au sein des religions. Assurément, la femme est l’avenir de Dieu.
Je profite de cet éditorial pour saluer deux femmes que nos fidèles lecteurs connaissent bien. Jennifer Schwarz, qui a été rédactrice en chef de votre magazine, s’envole aujourd’hui pour de nouvelles aventures. Je la remercie du fond du coeur pour l’enthousiasme et la générosité avec laquelle elle s’est investie pendant plus de cinq ans dans sa fonction. J’accueille aussi chaleureusement celle qui lui succède à ce poste : Virginie Larousse. Cette dernière a longtemps dirigé une revue universitaire consacrée aux religions et a enseigné l’histoire des religions à l’université de Bourgogne. Elle collaborait depuis de nombreuses années au Monde des Religions. [...]
Le Monde des Religions n° 59 – Mai/Juin 2013 –
Appelé à commenter l’événement en direct sur France 2, lorsque j’ai découvert que le nouveau pape était Jorge Mario Bergoglio, ma réaction immédiate a été de dire qu’il s’agissait d’un véritable événement spirituel. La première fois que j’avais entendu parler de l’archevêque de Buenos Aires, c’était une dizaine d’années plus tôt dans la bouche de l’abbé Pierre. Lors d’un voyage en Argentine, il avait été frappé par la simplicité de ce jésuite qui avait délaissé le magnifique palais épiscopal pour vivre dans un modeste appartement et qui se rendait fréquemment seul dans les bidonvilles.
Le choix du nom de François, en écho au Poverello d’Assise, n’a fait que confirmer que nous allions assister à un changement profond dans l’Église catholique. Non pas un changement dans la doctrine, ni même probablement dans la morale, mais dans la conception même de la papauté et dans le mode de gouvernance de l’Église. Se présentant devant les milliers de fidèles réunis place Saint-Pierre comme « l’évêque de Rome » et demandant à la foule de prier pour lui avant de prier avec elle, François a montré en quelques minutes, à travers de nombreux signes, qu’il entendait revenir à une conception humble de sa fonction. Une conception qui renoue avec celle des premiers chrétiens, qui n’avait pas encore fait de l’évêque de Rome non seulement le chef universel de toute la chrétienté, mais aussi un véritable monarque à la tête d’un État temporel.
Depuis son élection, François multiplie les gestes de charité. La question se pose maintenant de savoir jusqu’où il ira dans l’immense chantier de renouveau de l’Église qui l’attend. Va-t-il enfin réformer la curie romaine et la banque du Vatican, secoués par des scandales depuis plus de 30 ans ? Va-t-il mettre en œuvre un mode collégial de gouvernement de l’Église ? Va-t-il chercher à maintenir le statut actuel de l’État du Vatican, héritage des anciens États pontificaux, qui est en contradiction flagrante avec le témoignage de pauvreté de Jésus et son refus du pouvoir temporel ? Comment va-t-il faire face aussi aux défis de l’œcuménisme et du dialogue inter-religieux, sujets qui l’intéressent vivement ? Et encore à celui de l’évangélisation, dans un monde où le fossé ne cesse de se creuser entre le discours ecclésial et la vie des gens, surtout en Occident ? Une chose est sûre, François a les qualités de cœur et d’intelligence et même le charisme nécessaire pour apporter ce grand souffle de l’Évangile dans le monde catholique et au-delà, comme le montrent ses premières déclarations en faveur d’une paix mondiale fondée sur le respect de la diversité des cultures et même de toute la création (pour la première fois sans doute, les animaux ont un pape qui se soucie d’eux !). Les violentes critiques dont il a été l’objet dès le lendemain de son élection, l’accusant de connivence avec l’ancienne junte militaire alors qu’il était jeune supérieur des Jésuites, ont cessé quelques jours plus tard, après notamment que son compatriote et Prix Nobel de la paix, Adolfo Pérez Esquivel – emprisonné durant 14 mois et torturé par la junte militaire – a affirmé que le nouveau pape n’avait eu, contrairement à d’autres ecclésiastiques, « aucun lien avec la dictature ». François connaît donc un état de grâce qui peut le porter à toutes les audaces. À condition toutefois qu’il ne lui arrive pas le même sort que Jean Paul Ier, qui avait suscité tant d’espoirs avant de mourir de manière énigmatique moins d’un mois après son élection. François n’a sans doute pas tort de demander aux fidèles de prier pour lui.
www.lemondedesreligions.fr [...]
Le Monde des Religion n° 58 – Mars/Avril 2013 –
Il paraîtra sans doute étrange à certains de nos lecteurs qu’à la suite du vif débat parlementaire en France sur le mariage pour tous, nous consacrions une grande partie de ce dossier à la manière dont les religions considèrent l’homosexualité. Certes nous abordons les éléments essentiels de ce débat, qui touche aussi à la question de la filiation, dans la seconde partie du dossier, avec les points de vue contradictoires du Grand Rabbin de France Gilles Bernheim, des philosophes Olivier Abel et Thibaud Collin, de la psychanalyste et ethnologue Geneviève Delaisi de Parseval et de la sociologue Danièle Hervieu-Léger. Mais il me semble qu’une question importante a été en grande partie occultée jusqu’à présent : que pensent les religions de l’homosexualité et comment traitent-elles les homosexuels depuis des siècles ? Cette question a été esquivée par la plupart des responsables religieux eux-mêmes, qui ont d’emblée placé le débat sur le terrain de l’anthropologie et de la psychanalyse, et non sur celui de la théologie ou de la loi religieuse. On en comprend mieux les raisons lorsqu’on regarde de plus près la manière dont l’homosexualité est violemment critiquée par la plupart des textes sacrés et dont sont encore traités les homosexuels dans de nombreuses régions du monde au nom de la religion. Car si l’homosexualité était largement tolérée dans l’Antiquité, elle est présentée comme une perversion majeure dans les Écritures juives, chrétiennes et musulmanes. « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ce qu’ils font est une abomination ; ils seront mis à mort et leur sang retombera sur eux », est-il écrit dans le Lévitique (Lv 20, 13). La Mishna ne dira pas autre chose et les pères de l’Église n’auront pas de mots assez durs pour cette pratique qui « fait injure à Dieu » selon l’expression de Thomas d’Aquin, puisqu’elle viole, à ses yeux, l’ordre même de la nature voulu par le Tout-Puissant. Sous les règnes des très chrétiens empereurs Théodose ou Justinien, les homosexuels sont passibles de mort, car on les soupçonne de pactiser avec le diable et on les rend responsables des catastrophes naturelles ou des épidémies. Le Coran, dans une trentaine de versets, réprouve cet acte « contre-nature » et « outrancier », et la charia condamne encore de nos jours les hommes homosexuels à des peines, variant selon les pays, de l’emprisonnement à la pendaison, en passant par cent coups de bâtons. Les religions d’Asie sont dans l’ensemble plus tolérantes envers l’homosexualité, mais celle-ci est condamnée par le Vinaya, le code monastique des communautés bouddhistes, et certains courants de l’hindouisme. Même si les positions des institutions juives et chrétiennes se sont beaucoup assouplies au cours des dernières décennies, il n’en demeure pas moins que l’homosexualité est encore considérée comme un crime ou un délit dans une centaine de pays et qu’elle reste une des principales causes de suicide chez les jeunes (en France un homosexuel sur trois de moins de 20 ans a tenté de se suicider à cause du rejet social). C’est cette violente discrimination, portée depuis des millénaires par des arguments religieux, que nous voulions aussi rappeler.
Reste le débat, complexe et essentiel, non seulement sur le mariage, mais plus encore sur la famille (puisque ce n’est pas la question de l’égalité des droits civils entre couples homosexuels et hétérosexuels qui fait vraiment débat, mais celle de la filiation et des questions liées à la bioéthique). Ce débat dépasse les revendications des couples homosexuels, puisqu’il concerne les questions de l’adoption, de la procréation médicalement assistée et de la gestation pour autrui, qui peuvent toucher tout autant les couples hétérosexuels. Le gouvernement a eu la sagesse de le repousser à l’automne en sollicitant l’avis du Comité national d’éthique. Car voilà en effet des questions cruciales qu’on ne peut ni éviter, ni régler à coups d’arguments aussi simplistes que « cela bouleverse nos sociétés » – elles sont, de fait, déjà bouleversées – ou, au contraire, « c’est la marche inéluctable du monde » : toute évolution doit être évaluée à l’aune de ce qui est bon pour l’être humain et la société.
http://www.lemondedesreligions.fr/mensuel/2013/58/ [...]
Le Monde des Religions n° 57 – Janvier/Février 2013 –L’idée que chaque individu puisse « trouver sa voie spirituelle », est-elle éminemment moderne ? Oui et non. On trouve en Orient à l’époque du Bouddha de nombreux chercheurs de l’Absolu qui sont en quête d’un chemin personnel de libération. Dans l’Antiquité grecque et romaine, les cultes à mystères et les nombreuses écoles philosophiques – des pythagoriciens aux néoplatoniciens en passant par les stoïciens et les épicuriens – offrent de nombreuses voies initiatiques et de sagesse à des individus en quête d’une vie bonne. Le développement ultérieur des grandes aires de civilisation, fondées chacune sur une religion donnant sens à la vie individuelle et collective, va limiter l’offre spirituelle. Il n’en demeure pas moins qu’on trouvera toujours au sein de chaque grande tradition des courants spirituels divers, répondant à une certaine diversité des attentes individuelles. Ainsi, dans le christianisme, les nombreux ordres religieux offrent une assez grande variété de sensibilités spirituelles : des plus contemplatifs, comme les chartreux ou les carmes, aux plus intellectuels, comme les dominicains ou les jésuites, ou bien encore ceux mettant l’accent sur la pauvreté (franciscains), l’équilibre entre le travail et la prière (bénédictins) ou l’action caritative (frères et sœurs de Saint-Vincent de Paul, missionnaires de la charité).
Au-delà des personnes engagées dans la vie religieuse, on a vu se développer à partir de la fin du Moyen Âge des associations de laïcs, vivant le plus souvent dans la mouvance des grands ordres, même si celles-ci n’ont pas toujours été bien perçues par l’institution, comme le montre la persécution dont on été victimes les béguines. On trouve le même phénomène dans l’islam avec le développement de nombreuses confréries soufies, dont certaines seront aussi persécutées. La sensibilité mystique juive s’exprimera à travers la naissance du courant kabbaliste, et on continuera de trouver en Asie une grande diversité d’écoles et de courants spirituels. La modernité va apporter deux éléments nouveaux : la sortie de la religion collective et le brassage des cultures. On va ainsi assister à de nouveaux syncrétismes spirituels liés aux aspirations personnelles de chaque individu en quête de sens et voir se développer une spiritualité laïque qui s’exprime en dehors de toute croyance et de pratique religieuse. Cette situation n’est pas totalement inédite, car elle n’est pas sans rappeler celle de l’Antiquité romaine, mais le mélange des cultures y est beaucoup plus intense (chacun a accès aujourd’hui à tout le patrimoine spirituel de l’humanité), et on assiste aussi à une véritable démocratisation de la quête spirituelle qui ne concerne plus simplement une élite sociale.
Mais à travers toutes ces métamorphoses une question essentielle demeure : chaque individu doit-il chercher et peut-il trouver la voie spirituelle qui lui permette de se réaliser du mieux possible ? Je répond assurément : oui. Hier comme aujourd’hui le chemin spirituel est le fruit d’une démarche personnelle et celle-ci a plus de chance d’aboutir si chacun cherche un chemin qui soit adapté à sa sensibilité, à ses possibilités, à son ambition, à son désir, à son questionnement. Bien sûr, certains individus se trouvent perdus devant le choix si large de chemins qui nous sont aujourd’hui offerts. « Quelle est la meilleure voie spirituelle ? », a-t-on un jour demandé au dalaï-lama. Réponse du leader tibétain : « Celle qui vous rend meilleur. » Voici sans doute un excellent critère de discernement.
http://www.lemondedesreligions.fr/mensuel/2013/57/
Enregistrer [...]
Le Monde des religions n° 56 – nov/déc 2012 –
Il y a les fous de Dieu. Ceux qui tuent au nom de leur religion. Depuis Moïse, qui prescrit de massacrer les Cananéens, jusqu’aux djihadistes d’Al-Qaida en passant par le Grand Inquisiteur catholique, le fanatisme religieux revêt diverses formes au sein des monothéismes, mais prend toujours sa source dans le même creuset identitaire : on tue – ou on prescrit de tuer – pour protéger la pureté du sang ou de la foi, pour défendre la communauté (voire même une culture comme dans le cas de Brejvik) contre ceux qui la menace, pour étendre l’emprise de la religion sur la société. Le fanatisme religieux est une dramatique dérive d’un message biblique et coranique qui vise principalement à éduquer les êtres humains au respect d’autrui. C’est le poison secrété par le communautarisme : le sentiment d’appartenance – au peuple, à l’institution, à la communauté – devient plus important que le message lui même et « Dieu » n’est plus qu’un alibi pour se défendre et dominer.
Le fanatisme religieux a été parfaitement analysé et dénoncé par les philosophes des Lumières il y a plus de deux siècles. Ils se sont battus pour que puisse exister, au sein de sociétés encore dominées par la religion, une liberté de conscience et d’expression. Grace à eux, nous sommes aujourd’hui libres en Occident non seulement de croire ou de ne pas croire, mais aussi de critiquer la religion et d’en dénoncer les dangers. Mais ce combat et cette liberté si durement acquise ne doivent pas nous faire oublier que ces mêmes philosophes avaient pour objectif de permettre à tous de vivre en harmonie au sein d’un même espace politique. La liberté d’expression, qu’elle soit d’ordre intellectuel ou artistique, n’a donc pas pour vocation d’attaquer les autres dans le seul but de provoquer ou de susciter du conflit. D’ailleurs John Locke considérait, au nom de la paix sociale, que les athées les plus virulents devaient être interdits de parole publique, comme les catholiques les plus intransigeants ! Que dirait-il aujourd’hui face à ceux qui produisent et diffusent sur internet un film pitoyable d’un point de vue artistique, qui touche à ce qu’il y a de plus sacré pour les croyants musulmans – la figure du Prophète – dans le seul but d’activer les tensions entre l’Occident et le monde islamique ? Que dirait-il face à ceux qui en rajoutent en publiant de nouvelles caricatures de Mahomet, dans le but de vendre du papier, en soufflant sur les braises encore chaudes de la colère de nombreux musulmans dans le monde entier ? Tout cela pour quels résultats ? Des morts, des minorités chrétiennes de plus en plus menacées dans les pays musulmans, une tension accrue dans le monde entier. Le combat pour la liberté d’expression – aussi noble soit-il – ne dispense pas d’une analyse géopolitique de la situation : des groupes extrémistes instrumentalisent des images pour rassembler les foules autour d’un ennemi commun, un Occident fantasmé, réduit à un délire cinématographique et à quelques caricatures.
Nous vivons dans un monde interconnecté soumis à de nombreuses tensions qui menacent la paix du monde. Ce que prônaient les philosophes des Lumières à l’échelle d’une nation est aujourd’hui valable à l’échelle planétaire : les critiques caricaturales qui ont pour seul but de heurter les croyants et de provoquer les plus extrémistes d’entre eux sont stupides et dangereuses. Elles ont surtout pour principal effet de renforcer le camp des fous de Dieu et de fragiliser les efforts de ceux qui essayent d’établir un dialogue constructif entre les cultures et les religions. La liberté implique la responsabilité et le souci du bien commun. Sans quoi aucune société n’est viable.
http://www.lemondedesreligions.fr/mensuel/2012/56/
Enregistrer [...]
Le Monde des religions n° 55 – septembre/octobre 2012 —
Il y a une trentaine d’années, quand j’ai commencé mes études de sociologie et d’histoire des religions, on ne parlait que de « sécularisation » et la plupart des spécialistes du fait religieux pensaient que la religion allait progressivement se métamorphoser, puis se dissoudre, au sein des sociétés européennes de plus en plus marquées par le matérialisme et l’individualisme. Le modèle européen s’étendrait ensuite au reste du monde avec la globalisation des valeurs et des modes de vie occidentaux. Bref, la religion était condamnée à plus ou moins long terme.
Depuis une dizaine d’années, le modèle et l’analyse se sont inversés : on parle de « désécularisation », on constate partout l’essor de mouvements religieux identitaires et conservateurs et Peter Berger, le grand sociologue des religions américain, constate que « le monde est toujours aussi furieusement religieux qu’il l’a toujours été ». L’Europe est dès lors perçue comme une exception mondiale, mais qui risque à son tour d’être de plus en plus touchée par cette nouvelle vague religieuse.
Alors, quel scénario pour l’avenir ? À partir des tendances actuelles, des observateurs avisés offrent dans le grand dossier de ce numéro un panorama possible des religions dans le monde à l’horizon de 2050. Le christianisme accentuerait son avance sur les autres religions, notamment grâce à la démographie des pays du Sud mais aussi par la forte poussée des évangéliques et des pentecôtistes sur les cinq continents. L’islam continuerait de progresser par sa démographie, mais celle-ci devrait fortement se ralentir, notamment en Europe et en Asie, ce qui limitera à terme l’essor de la religion musulmane qui suscite beaucoup moins de conversions que le christianisme. L’hindouisme et le bouddhisme resteraient à peu près stables, même si les valeurs et certaines pratiques de ce dernier (comme la méditation) continueront à se diffuser de plus en plus largement en Occident et en Amérique latine. Comme les autres religions, très minoritaires, liées à la transmission par le sang, le judaïsme restera stable ou déclinera selon les différents scénarios démographiques et le nombre de mariages mixtes.
Mais au-delà de ces grandes tendances, comme le rappellent ici chacun à leur manière Jean-Paul Willaime et Raphaël Liogier, les religions continueront de se transformer et de subir les effets de la modernité, notamment l’individualisation et la globalisation. Aujourd’hui les individus ont une vision de plus en plus personnelle de la religion et se fabriquent leur propre dispositif de sens, parfois syncrétique, souvent bricolé. Même les mouvements intégristes ou fondamentalistes sont le produit d’individus ou de groupes d’individus qui bricolent en réinventant « une pure religion des origines ». Tant que se poursuivra le processus de mondialisation, les religions continueront de fournir des repères identitaires à des individus qui en manquent et qui sont inquiets ou se sentent culturellement envahis ou dominés. Et tant que l’homme sera en quête de sens, il continuera à chercher des réponses dans le vaste patrimoine religieux de l’humanité. Mais ces quêtes identitaires et spirituelles ne peuvent plus être vécues, comme par le passé, au sein d’une tradition immuable ou d’un dispositif institutionnel normatif. L’avenir des religions ne se joue donc pas seulement en nombre de fidèles, mais aussi dans la manière dont ces derniers vont réinterpréter l’héritage du passé. Et c’est bien là le plus grand point d’interrogation qui rend périlleuse toute analyse prospective à long terme. Alors, faute de rationalité, on peut toujours imaginer et rêver. C’est aussi ce que nous vous proposons dans ce numéro, à travers nos chroniqueurs, qui ont accepté de répondre à la question : « À quelle religion rêvez-vous pour 2050 ? »
Enregistrer [...]
Le Monde des religions n° 54 – juillet/août 2012 —
Des études scientifiques de plus en plus nombreuses montrent la corrélation entre foi et guérison et confirment les observations faites depuis la nuit des temps : l’animal pensant qu’est l’homme a un rapport différent à la vie, à la maladie, à la mort, selon l’état de confiance dans lequel il se trouve. De la confiance en soi, en son thérapeute, en la science, en Dieu, en passant par les chemins de l’effet placebo, découle une question capitale : croire aide-t-il à guérir ? Quelles sont les influences de l’esprit – à travers par exemple la prière ou la méditation – sur le processus de guérison ? Quelle importance peuvent aussi avoir les propres convictions du médecin dans sa relation de soin et d’aide au malade ? Ces questions importantes éclairent d’un jour nouveau les questions essentielles : qu’est-ce que la maladie ? Que signifie « guérir » ?
La guérison est toujours in fine une autoguérison : c’est le corps et l’esprit du malade qui produisent la guérison. C’est par la régénération cellulaire que le corps retrouve un équilibre qu’il avait perdu. Il est souvent utile, voire nécessaire, d’aider le corps malade par un acte thérapeutique et l’absorption de médicaments. Mais ceux-ci ne font qu’aider le processus d’autoguérison du patient. La dimension psychique, la foi, le moral, l’environnement relationnel, jouent aussi un rôle déterminant dans ce processus de guérison. C’est donc toute la personne qui est mobilisée pour guérir. L’équilibre du corps et de la psyché ne peut être rétabli sans un véritable engagement du malade à retrouver la santé, sans une confiance aux soins qu’on lui prodigue et éventuellement, pour certains, une confiance en la vie en général ou en une force supérieure bienveillante qui les aide. De même, parfois, une guérison, c’est-à-dire un retour à l’équilibre, ne peut se faire sans qu’il y ait aussi un changement dans l’environnement du malade : son rythme et son mode de vie, son alimentation, sa manière de respirer ou de traiter son corps, ses relations affectives, amicales, professionnelles. Car bien des maladies sont le symptôme local d’un déséquilibre plus global de la vie du patient. Si celui-ci n’en prend pas conscience, il ira de maladies en maladies, ou souffrira de maladies chroniques, de dépression, etc.
Ce que les chemins de la guérison nous enseignent, c’est qu’on ne peut traiter un être humain comme une machine. On ne peut soigner une personne comme on répare un vélo, en changeant une roue voilée ou un pneu crevé. C’est la dimension sociale, affective et spirituelle de l’homme qui s’exprime dans la maladie et c’est cette dimension globale qu’il faut prendre en compte pour le soigner. Tant que nous n’aurons pas vraiment intégré cela, il y a des chances que la France reste encore longtemps championne du monde de la consommation d’anxiolytiques, d’antidépresseurs et du déficit de sa sécurité sociale.
Enregistrer [...]
Le Monde des religions n° 53 – mai/juin 2012 —
L’heure est aujourd’hui davantage à la quête identitaire, à la redécouverte de ses propres racines culturelles, à la solidarité communautaire. Et, hélas, de plus en plus aussi : au repli sur soi, à la peur de l’autre, à la rigidité morale et au dogmatisme étroit. Aucune région du monde, aucune religion, n’échappe à ce vaste mouvement planétaire de retour identitaire et normatif. De Londres au Caire, en passant par Delhi, Houston ou Jérusalem, l’heure est bien au voilage ou au perruquage des femmes, aux sermons rigoristes, au triomphe des gardiens du dogme. Contrairement à ce que j’ai vécu à la fin des années 1970, les jeunes qui s’intéressent encore à la religion le sont pour la plupart moins par désir de sagesse ou quête de soi que par besoin de repères forts et désir d’ancrage dans la tradition de leurs pères.
Fort heureusement, ce mouvement n’a rien d’inéluctable. Il est né comme un antidote aux excès d’une mondialisation non maîtrisée et d’une individualisation brutale de nos sociétés. En réaction aussi à un libéralisme économique déshumanisant et à une libéralisation des mœurs très rapide. Nous assistons donc à un très classique retour du balancier. Après la liberté, la loi. Après l’individu, le groupe. Après les utopies de changement, la sécurité des modèles du passé.
Je reconnais d’ailleurs volontiers qu’il y quelque chose de sain dans ce retour identitaire. Après un excès d’individualisme libertaire et consumériste, il est bon de redécouvrir l’importance du lien social, de la loi, de la vertu. Ce que je déplore, c’est le caractère trop rigoriste et intolérant de la plupart des retours actuels à la religion. On peut se réinscrire dans une communauté sans verser dans le communautarisme ; adhérer au message millénaire d’une grande tradition sans devenir sectaire ; vouloir mener une vie vertueuse sans être moralisant.
Face à ces raidissements, il existe fort heureusement un antidote interne aux religions : la spiritualité. Plus les croyants creuseront au sein de leur propre tradition, plus ils y découvriront des trésors de sagesse susceptibles de toucher leur cœur et d’ouvrir leur intelligence, de leur rappeler que tous les êtres humains sont frères et que la violence et le jugement d’autrui sont des fautes plus graves que la transgression des règles religieuses. Le développement de l’intolérance religieuse et des communautarismes m’inquiète, mais pas les religions en tant que telles qui peuvent certes produire le pire, mais aussi apporter le meilleur.
Enregistrer [...]
Le Monde des religions n° 52 – mars/avril 2012 —
La question du vote des Français en fonction de leur religion est très rarement abordée. Même si, en vertu du principe de laïcité, l’appartenance religieuse n’est plus demandée dans les recensements depuis le début de la IIIe République, nous disposons d’enquêtes d’opinion qui, elles, donnent quelques éléments à ce sujet. Du fait d’un échantillonnage trop étroit, celles-ci ne peuvent toutefois mesurer les religions trop minoritaires, comme le judaïsme, le protestantisme ou le bouddhisme, qui ont chacune moins d’un million de fidèles. On peut toutefois se faire une idée précise du vote des personnes se déclarant catholiques (environ 60 % des Français, dont 25 % de pratiquants) et musulmans (environ 5 %), mais aussi des personnes se déclarant « sans religion » (environ 30 % des Français). Un sondage Sofres/Pèlerin Magazine effectué en janvier dernier confirme l’ancrage historique à droite des catholiques français. Au premier tour, 33 % d’entre eux voteraient pour Nicolas Sarkozy, et le score passe à 44 % chez les catholiques pratiquants. Ils seraient également 21 % à voter pour Marine Le Pen, mais le score se réduit à celui de la moyenne nationale chez les pratiquants (18 %). Au second tour, 53 % des catholiques voteraient pour Nicolas Sarkozy contre 47 % pour François Hollande, et les pratiquants voteraient à 67 % pour le candidat de droite – et même à 75 % pour les pratiquants réguliers.Ce sondage nous apprend également que si les catholiques s’alignent sur la moyenne de l’ensemble des Français pour mettre la défense de l’emploi et la défense du pouvoir d’achat comme leurs deux principales préoccupations, ils sont moins nombreux que les autres à se préoccuper de la réduction des inégalités et de la pauvreté… mais plus nombreux à se soucier de la lutte contre la délinquance. La foi et les valeurs évangéliques pèsent finalement moins dans le vote politique de la majorité des catholiques que les préoccupations d’ordre économique ou sécuritaire. Peu importe, d’ailleurs, que le candidat soit catholique ou non. Il est ainsi frappant de constater que le seul candidat majeur à l’élection présidentielle qui affiche clairement sa pratique catholique, François Bayrou, ne recueille pas plus d’intentions de vote chez les catholiques que dans le reste de la population. La plupart des catholiques français, et surtout les pratiquants, sont avant tout attachés à un système de valeurs fondé sur l’ordre et la stabilité. Or François Bayrou, sur différentes questions de société aux enjeux éthiques fondamentaux, a un point de vue progressiste. De quoi déstabiliser, sans doute, une bonne partie de l’électorat catholique traditionnel. Nicolas Sarkozy l’a sans doute bien senti, lui qui, sur les lois de bioéthique, l’homoparentalité ou encore le mariage homosexuel, reste en conformité avec des positions catholiques traditionnelles.Enfin, les enquêtes menées par le Centre de recherches politique de Sciences Po montrent que les musulmans français, à l’inverse des catholiques, votent massivement à gauche (78 %). Même si les trois quarts d’entre eux occupent des emplois faiblement qualifiés, on constate toutefois un vote spécifiquement lié à la religion puisque 48 % des ouvriers et des employés musulmans se classent à gauche, contre 26 % des ouvriers et des employés catholiques et 36 % des ouvriers et des employés « sans religion ». Dans leur ensemble, les « sans religion » – une catégorie qui ne cesse de grandir – votent d’ailleurs aussi fortement à gauche (71 %). Apparaît donc une étrange alliance, entre des « sans religion » – le plus souvent progressistes sur les questions sociétales – et les musulmans français, sans doute plus conservateurs sur ces mêmes questions, mais engagés dans une logique du « tout sauf Sarkozy ». [...]
Le Monde des religions n°51 – janvier/février 2012 —
Notre dossier met en évidence un fait important : l’expérience spirituelle sous ses formes très diverses – prière, transe chamanique, méditation – a une inscription corporelle dans le cerveau. Au-delà du débat philosophique qui en découle et des interprétations matérialistes ou spiritualistes que l’on peut en faire, je retiens un autre enseignement de ce fait. C’est que la spiritualité est d’abord, et avant tout, une expérience vécue qui touche l’esprit autant que le corps. Selon le conditionnement culturel de chacun, elle renverra à des objets ou à des représentations très différentes : rencontre avec Dieu, avec une force ou un absolu indicible, avec la profondeur mystérieuse de l’esprit. Mais ces représentations auront toujours pour point commun de susciter un ébranlement de l’être, un élargissement de la conscience et bien souvent du cœur. Le sacré, quel que soit le nom ou la forme qu’on lui donne, transforme celui qui l’éprouve. Et il le bouleverse dans tout son être : corps émotionnel, psyché, esprit. De nombreux croyants ne font pourtant pas cette expérience. Pour eux, la religion est avant tout un marqueur identitaire personnel et collectif, une morale, un ensemble de croyances et de règles à observer. Bref, la religion est réduite à sa dimension sociale et culturelle.
On peut pointer dans l’histoire le moment où cette dimension sociale de la religion est apparue et l’a peu à peu emporté sur l’expérience personnelle : le passage de la vie nomade, où l’homme vivait en communion avec la nature, à la vie sédentaire, où il a créé des cités et a remplacé les esprits de la nature – avec lesquels il entrait en contact grâce à des états modifiés de conscience – par les dieux de la cité à qui il a offert des sacrifices. L’étymologie même du mot sacrifice – « faire le sacré » – montre bien que le sacré ne s’éprouve plus : il se fait à travers un geste rituel (offrande aux dieux) censé garantir l’ordre du monde et protéger la cité. Et ce geste est délégué par le peuple, devenu nombreux, à un clergé spécialisé. La religion revêt dès lors une dimension essentiellement sociale et politique : elle crée du lien et soude une communauté autour de grandes croyances, de règles éthiques et de rituels partagés.
C’est en réaction à cette dimension trop extérieure et collective que vont apparaître dans toutes les civilisations, vers le milieu du premier millénaire avant notre ère, des sages très divers qui entendent réhabiliter l’expérience personnelle du sacré : Lao Tseu en Chine, les auteurs des Upanishads et le Bouddha en Inde, Zoroastre en Perse, les initiateurs des cultes à mystères et Pythagore en Grèce, les prophètes d’Israël jusqu’à Jésus. Ces courants spirituels naissent bien souvent au sein des traditions religieuses qu’ils tendent à transformer en les contestant de l’intérieur. Cette extraordinaire poussée de mysticisme, qui ne cesse d’étonner les historiens par sa convergence et sa synchronicité dans les différentes cultures du monde, va bouleverser les religions en y introduisant une dimension personnelle qui renoue par bien des aspects avec l’expérience du sacré sauvage des sociétés primitives. Et je suis frappé de voir combien notre époque ressemble à cette période antique : c’est cette même dimension qui intéresse de plus en plus nos contemporains, dont beaucoup ont pris leurs distances avec la religion qu’ils jugent trop froide, sociale, extérieure. C’est tout le paradoxe d’une ultramodernité qui tente de renouer avec les formes les plus archaïques du sacré : un sacré qui s’éprouve plus qu’il ne se « fait ». Le XXIe siècle est donc à la fois religieux par la résurgence identitaire face aux peurs engendrées par une mondialisation trop rapide, mais aussi spirituel par ce besoin d’expérience et de transformation de l’être que ressentent de nombreux individus, qu’ils soient religieux ou non. [...]
Le Monde des religions n° 50 – novembre/décembre 2011 —
La fin du monde aura-t-elle lieu le 21 décembre 2012 ? Longtemps je n’ai prêté aucune attention à la fameuse prophétie attribuée aux Mayas. Mais, depuis quelques mois, de nombreuses personnes m’interrogent sur la question, m’assurant souvent que leurs adolescents sont angoissés par les informations qu’ils lisent sur Internet ou marqués par 2012, le film catastrophe hollywoodien. La prophétie maya est-elle authentique ? Y a-t-il d’autres prophéties religieuses de la fin imminente du monde, comme on peut le lire sur la Toile ? Que disent les religions de la fin des temps ? Le dossier de ce numéro répond à ces questions. Mais le succès de cette rumeur autour du 21 décembre 2012 en appelle une autre : comment expliquer l’angoisse de nombre de nos contemporains, pour la plupart non religieux, et pour qui une telle rumeur apparaît plausible ? Je vois deux explications.
Nous vivons tout d’abord une époque particulièrement angoissante, où l’homme a le sentiment d’être à bord d’un bolide dont il a perdu le contrôle. De fait, plus aucune institution, plus aucun État ne semble en mesure de freiner la course vers l’inconnu – et peut-être l’abîme – dans laquelle nous précipitent l’idéologie consumériste et la mondialisation économique sous l’égide du capitalisme ultralibéral : accentuations dramatiques des inégalités ; catastrophes écologiques menaçant l’ensemble de la planète ; spéculation financière incontrôlée qui fragilise toute l’économie mondiale devenue globale. Il y a ensuite les bouleversements de nos modes de vie qui ont fait de l’homme occidental un déraciné amnésique, mais tout aussi incapable de se projeter dans le futur. Nos modes de vies ont sans doute plus changé au cours du siècle écoulé qu’ils n’avaient changé au cours des trois ou quatre millénaires précédents. L’Européen « d’avant » vivait majoritairement à la campagne, il était observateur de la nature, enraciné dans un monde rural lent et solidaire, ainsi que dans des traditions séculaires. Il en allait de même pour l’homme du Moyen-Âge ou de l’homme de l’Antiquité. L’Européen d’aujourd’hui est très majoritairement citadin ; il se sent relié à la planète entière, mais il est sans attaches locales fortes ; il mène une existence individualiste dans un rythme effréné et s’est le plus souvent coupé des traditions séculaires de ses pères. Il faut sans doute remonter au tournant du néolithique (vers 10 000 ans avant notre ère au Proche-Orient et vers 3 000 ans avant notre ère en Europe), lorsque les hommes ont quitté une vie nomade de chasseurs-cueilleurs et se sont sédentarisés dans des villages en développant l’agriculture et l’élevage, pour trouver une révolution aussi radicale que celle que nous sommes en train de vivre. Cela n’est pas sans conséquences profondes sur notre psychisme. La vitesse avec laquelle cette révolution s’est produite engendre incertitude, perte des repères fondamentaux, précarisation des liens sociaux. Elle est source d’inquiétude, d’angoisse, d’un sentiment confus de fragilité de l’individu comme des communautés humaines, d’où une sensibilité accrue aux thématiques de destruction, de dislocation, d’anéantissement.
Une chose me paraît certaine : nous ne vivons pas les symptômes de la fin du monde, mais de la fin d’un monde. Celui du monde traditionnel plusieurs fois millénaire que je viens de décrire avec tous les schémas de pensée qui lui étaient associés, mais aussi celui du monde ultra-individualiste et consumériste qui lui a succédé, dans lequel nous sommes encore plongés, qui donne tant de signes d’essoufflement et montre ses vraies limites pour un progrès véritable de l’homme et des sociétés. Bergson disait que nous aurions besoin d’un « supplément d’âme » pour faire face aux défis nouveaux. Nous pouvons en effet voir dans cette crise profonde non seulement une série de catastrophes écologiques, économiques et sociales annoncées, mais aussi la chance d’un sursaut, d’un renouveau humaniste et spirituel, par un éveil de la conscience et un sens plus aiguisé de la responsabilité individuelle et collective. [...]
Le Monde des religions n° 49 – septembre/octobre 2011 —
Le renforcement des fondamentalismes et des communautarismes de tous bords est l’un des principaux effets du 11-Septembre. Cette tragédie au retentissement planétaire a révélé et accentué la fracture islam-Occident, comme elle a été le symptôme et l’accélérateur de toutes les peurs liées à la mondialisation ultrarapide des décennies précédentes et au choc des cultures qui en découle. Mais ces crispations identitaires qui ne cessent d’inquiéter et qui alimentent sans cesse la chronique médiatique (le massacre d’Oslo qui s’est produit en juillet en est l’une des dernières manifestations), ont laissé dans l’ombre une autre conséquence du 11-Septembre, tout à fait opposée : le rejet des monothéismes à cause, précisément, du fanatisme qu’ils suscitent. Les récentes enquêtes d’opinion en Europe montrent que les religions monothéistes font de plus en plus peur à nos contemporains. Les mots « violence » et « régression » leur sont dorénavant plus volontiers attachés que « paix » et « progrès ». L’une des conséquences de ce retour identitaire religieux et du fanatisme qui en découle souvent est donc une forte augmentation de l’athéisme.Si le mouvement est général en Occident, c’est en France que le phénomène est le plus frappant. Il y a deux fois plus d’athées qu’il y a dix ans et la majorité des Français se disent aujourd’hui soit athées, soit agnostiques. Bien entendu, les causes de cette forte poussée de l’incroyance et de l’indifférence religieuse sont plus profondes et nous les analysons dans ce dossier : développement de l’esprit critique et de l’individualisme, mode de vie urbain et perte de la transmission religieuse, etc. Mais nul doute que la violence religieuse contemporaine accentue un phénomène massif de détachement à l’égard de la religion, qui est beaucoup moins spectaculaire que la folie meurtrière des fanatiques. On pourrait reprendre le dicton : le bruit de l’arbre qui tombe cache celui de la forêt qui pousse. Or, parce qu’ils nous inquiètent à juste titre et fragilisent la paix mondiale à court terme, nous nous focalisons beaucoup trop sur le regain des fondamentalismes et des communautarismes, en oubliant de voir que la véritable mutation à l’échelle de l’histoire longue est le déclin profond, dans toutes les couches de la population, de la religion et de la croyance millénaire en Dieu.
On me dira que le phénomène est européen et surtout impressionnant en France. Certes, mais il ne cesse de s’accentuer et la tendance commence même à gagner la côte est des États-Unis. La France, après avoir été la fille aînée de l’église, pourrait bien devenir la fille aînée de l’indifférence religieuse. Le printemps des pays arabes montre aussi que l’aspiration aux libertés individuelles est universelle et pourrait bien avoir comme ultime conséquence, dans le monde musulman, comme dans le monde occidental, l’émancipation de l’individu à l’égard de la religion et la « mort de Dieu » prophétisée par Nietzsche. Les gardiens du dogme l’ont bien compris, eux qui ne cessent de condamner les dangers de l’individualisme et du relativisme. Mais peut-on empêcher un besoin humain aussi fondamental que la liberté de croire, de penser, de choisir ses valeurs et le sens que l’on veut donner à sa vie ?
À long terme, l’avenir de la religion ne me semble guère résider dans l’identité collective et dans la soumission de l’individu au groupe, comme ce fut le cas pendant des millénaires, mais dans la quête spirituelle personnelle et la responsabilité. La phase d’athéisme et de rejet de la religion dans laquelle nous pénétrons de plus en plus profondément peut bien entendu déboucher sur un consumérisme triomphant, une indifférence à l’autre, de nouvelles barbaries. Mais elle peut aussi être le prélude à de nouvelles formes de spiritualité, laïques ou religieuses, véritablement fondées sur les grandes valeurs universelles auxquelles nous aspirons tous : la vérité, la liberté, l’amour. Alors Dieu – ou plutôt toutes ses représentations traditionnelles – ne sera pas mort pour rien. [...]
Le Monde des religions n° 48 – Juillet/Août 2011 —
Alors que le feuilleton de l’affaire DSK continue de faire des vagues et de susciter maints débats et interrogations, il est un enseignement que Socrate transmet au jeune Alcibiade qu’il conviendrait de méditer : “Pour prétendre gouverner la cité, il faut apprendre à se gouverner soi-même.” Si Dominique Strauss-Kahn, jusqu’à cette affaire, favori des sondages, devait être reconnu coupable de violences sexuelles sur une femme de ménage du Sofitel de New York, on pourra non seulement plaindre la victime, mais aussi pousser un grand “ouf” de soulagement. Car si DSK, comme certains témoignages en France semblent aussi le laisser penser, est un compulsif sexuel capable de brutalité, nous aurions pu élire au sommet de l’État soit un malade (s’il ne peut se dominer), soit un vicieux (s’il ne veut se dominer). Quand on voit l’état de choc que la nouvelle de son arrestations a provoqué dans notre pays, on ose à peine se demander ce qui serait arrivé si une telle affaire avec éclaté un an plus tard ! La sidération des Français, qui confine au déni, tient beaucoup aux espoirs que l’on avait mis en DSK en tant qu’homme sérieux et responsable pour gouverner et représenter dignement la France dans le monde. Cette attente venait d’une déception à l’égard de Nicolas Sarkozy, jugé sévèrement pour ses contradictions entre ses grandes déclarations sur la justice sociale et la morale, et son attitude personnelle, notamment vis-à-vis de l’argent. On espérait donc un homme moralement plus exemplaire. La chute de DSK, quel que soit le résultat du procès, est d’autant plus dure à digérer.
Elle a pourtant le mérite de replacer dans le débat public la question de la vertu en politique. Car si cette question est capitale aux États-Unis, elle est tout à fait minorée en France, où l’on tend à séparer totalement vie privée et vie publique, personnalité et compétence. Je pense que l’attitude juste se situe entre ces deux extrêmes : trop de moralisme aux États-Unis, pas assez d’attention à la morale personnelle des hommes politiques en France. Car sans tomber dans le travers américain de la “chasse au péché” des hommes publics, il faut se rappeler, comme le dit Socrate à Alcibiade, que l’on peut douter des bonnes qualités de gouvernance d’un homme soumis à ses passions. Les plus hautes responsabilité exigent l’acquisition de certaines vertus : maîtrise de soi, prudence, respect de la vérité et de la justice. Comment un homme qui n’aurait su acquérir pour lui-même ces vertus morales élémentaires peut-il bien les mettre en oeuvre dans le gouvernement de la cité ? Lorsqu l’on se comporte mal au sommet de l’État, comment demander à tous d’agir de manière bonne ? Confucius disait il y a deux mille cinq cents ans au souverain du Ji Kang : “Cherchez vous-même le bien et le peuple s’améliorera. La vertu de l’homme de bien est pareille à celle du vent. La vertu du peuple est pareille à celle de l’herbe, elle se plie dans le sens du vent” (Entretiens, 12/19). Même si le propos sonne un peu paternaliste à nos oreilles de modernes, il n’est pas sans vérité. [...]
Le Monde des religions n°47, mai-juin 2011 —
Le vent de liberté qui souffle sur les pays arabes depuis quelques mois inquiète les chancelleries occidentales. Traumatisés par la révolution iranienne, nous avons soutenu pendant des décennies des dictatures censées être un rempart contre l’islamisme. Peu nous importait que les droits de l’homme les plus fondamentaux soient bafoués, que la liberté d’expression n’existe pas, que les démocrates soient emprisonnés, qu’une petite caste corrompue pille toutes les ressources du pays à son profit… Nous pouvions dormir en paix : ces dictateurs dociles nous préservaient de l’éventuelle prise de pouvoir d’incontrôlables islamistes. Ce que nous voyons aujourd’hui, c’est que ces peuples se révoltent parce qu’ils aspirent, comme nous, à deux valeurs qui fondent la dignité humaine : la justice et la liberté. Ce ne sont pas des idéologues barbus qui ont lancé ces révoltes, mais de jeunes chômeurs désespérés, des hommes et des femmes éduqués et indignés, des citoyens de toutes catégories sociales qui réclament la fin de l’oppression et de l’iniquité. Des gens qui veulent vivre librement, que les ressources soient plus justement partagées et distribuées, qu’une justice et qu’une presse indépendante puissent exister. Ces gens, dont nous pensions qu’ils n’étaient capables de vivre que sous la poigne de fer d’un bon dictateur, nous donnent aujourd’hui une leçon exemplaire de démocratie. Espérons que le chaos ou une reprise en main violente n’étoufferont pas les flammes de la liberté. Et comment faire semblant d’oublier qu’il y a deux siècles, nous avons fait nos révolutions pour les mêmes raisons ?Certes, l’islamisme politique est un poison. De l’assassinat des chrétiens coptes en Égypte à celui du gouverneur du Punjab favorable à la révision de la loi sur le blasphème au Pakistan, ils ne cessent de semer la terreur au nom de Dieu et nous devons lutter de toutes nos forces contre le développement de ce mal. Mais ce n’est certainement pas en soutenant d’impitoyables dictatures que nous allons l’enrayer, bien au contraire. On sait que l’islamisme se nourrit de la haine de l’Occident et une bonne partie de cette haine vient justement de ce double discours que nous tenons sans cesse au nom de la realpolitik : oui aux grands principes démocratiques, non à leur application dans les pays musulmans pour mieux les contrôler. J’ajouterais que cette peur de la prise de pouvoir par les islamistes me semble de moins en moins plausible. Non seulement parce que les fers de lance des révoltes actuelles en Tunisie, en Égypte ou en Algérie sont très éloignés des milieux islamistes, mais aussi parce que, même si les partis islamiques vont nécessairement prendre une place importante dans le jeu démocratique à venir, ils ont extrêmement peu de chance de détenir une majorité. Et quand bien même cela arriverait, comme en Turquie au milieu des années 1990, il n’est pas dit que la population les autorise à instaurer la charia et les affranchisse de la sanction électorale. Les peuples qui tentent de se débarrasser de longues dictatures n’ont guère envie de retomber sous le joug de nouveaux despotes qui leur supprimeraient une liberté si longtemps désirée et si chèrement acquise. Les peuples arabes ont observé très attentivement l’expérience iranienne et sont parfaitement lucides sur la tyrannie que les ayatollahs et les mollahs exercent sur toute la société. Ce n’est pas au moment où les Iraniens cherchent à sortir de la cruelle expérience théocratique que leurs voisins risquent d’en rêver. Laissons donc de côté nos peurs et nos bas calculs politiciens pour soutenir avec enthousiasme et sans réserve les peuples qui se dressent contre leurs tyrans.
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer [...]
Le Monde des religions n° 44, novembre-décembre 2010 —
Le formidable succès du film Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois me réjouit profondément. Cet engouement ne manque pas de surprendre et j’aimerais dire ici pourquoi ce film m’a touché et pourquoi je pense qu’il a touché tant de spectateurs. Son premier point fort tient à sa sobriété et à sa lenteur. Pas de grands discours, peu de musique, de longs « plans séquences » où la camera s’arrête sur les visages et les attitudes, plutôt qu’une série de plans rapides alternés à la manière des bandes-annonces.
Dans un monde agité, bruyant, où tout va trop vite, ce film nous permet de plonger pendant deux heures dans une temporalité différente qui porte à l’intériorité. Certains n’y parviennent pas et s’ennuient un peu, mais la plupart des spectateurs vivent un voyage intérieur d’une grande richesse. Car les moines de Tibhirine, interprétés par des acteurs admirables, nous entraînent dans leur foi et dans leurs doutes. Et c’est la deuxième grande qualité du film : loin de tout manichéisme, il nous montre les hésitations des moines, leurs forces et leurs faiblesses.
Filmant au plus près du réel, et parfaitement épaulé par le religieux Henri Quinson, Xavier Beauvois brosse le portrait d’hommes aux antipodes des supers-héros hollywoodiens, à la fois tourmentés et sereins, angoissés et confiants, et qui ne cessent de s’interroger sur l’utilité de rester en un lieu où ils risquent d’être assassinés à tout moment. Ces moines, qui vivent pourtant une vie aux antipodes de la nôtre, nous deviennent alors proches. Nous sommes touchés, croyants ou incroyants, par leur foi limpide et par leurs peurs, nous comprenons leurs doutes, nous ressentons leur attachement à ce lieu et à la population.
Cette fidélité à ces villageois auprès de qui ils vivent, et qui sera d’ailleurs la principale raison de leur refus de partir, et donc de leur fin tragique, constitue sans nul doute la troisième force de ce film. Car ces religieux catholiques ont fait le choix de vivre dans un pays musulman qu’ils aiment profondément, et ils entretiennent avec la population une relation de confiance et d’amitié qui montre que le choc des civilisations n’est en rien une fatalité. Lorsque l’on se connaît, lorsque l’on vit ensemble, les peurs et les préjugés tombent et chacun peut vivre sa foi dans le respect de celle de l’autre.
C’est ce qu’exprime de manière bouleversante le prieur du monastère, le père Christian de Chergé, dans son testament spirituel lu en voix off par Lambert Wilson à la fin du film, lorsque les moines sont kidnappés et partent vers leur destin tragique : « S’il m’arrivait un jour – et ça pourrait être aujourd’hui – d’être victime du terrorisme qui semble vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant en Algérie, j’aimerais que ma communauté, mon Église, ma famille se souviennent que ma vie était donnée à Dieu et à ce pays . J’ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal qui semble, hélas, prévaloir dans le monde, et même de celui-là qui me frapperait aveuglément . J’aimerais, le moment venu, avoir ce laps de lucidité qui me permettrait de solliciter le pardon de Dieu et celui de mes frères en humanité, en même temps que de pardonner de tout cœur à qui m’aurait atteint . »
L’histoire de ces moines, tout autant qu’un témoignage de foi, est une véritable leçon d’humanité.
Lien vers vidéo
Enregistrer [...]
Le Monde des religions n°43, septembre-octobre 2010 —
Dans son dernier essai*, Jean-Pierre Denis, le directeur de la rédaction de l’hebdomadaire chrétien La Vie, montre comment, au cours des dernières décennies, la contre-culture libertaire issue de Mai-68 est devenue la culture dominante, tandis que le christianisme est devenu une contre-culture périphérique. L’analyse est pertinente et l’auteur plaide avec éloquence pour « un christianisme d’objection » qui ne soit ni conquérant, ni défensif. La lecture de cet ouvrage m’inspire quelques réflexions, à commencer par une question qui paraîtra à de nombreux lecteurs pour le moins provocatrice : notre monde a-t-il jamais été chrétien ? Qu’il y ait eu une culture dite « chrétienne », marquée par les croyances, les symboles et les rituels de la religion chrétienne, c’est une évidence. Que cette culture ait imprégné en profondeur notre civilisation, au point que même laïcisées, nos sociétés restent encore imprégnées d’un héritage chrétien omniprésent – calendrier, fêtes, édifices, patrimoine artistique, expressions populaires, etc. -, est indiscutable. Mais ce que les historiens appellent « la chrétienté », cette période de mille ans qui court de la fin de l’Antiquité à la Renaissance et qui marque la conjonction de la religion chrétienne et des sociétés européennes, a-t-elle jamais été chrétienne en son sens profond, c’est-à-dire fidèle au message du Christ ? Pour Sören Kierkegaard, penseur chrétien fervent et tourmenté, « toute la chrétienté n’est autre chose que l’effort du genre humain pour retomber sur ses pattes, pour se débarrasser du christianisme ». Ce que souligne avec pertinence le philosophe danois, c’est que le message de Jésus est totalement subversif à l’égard de la morale, du pouvoir et de la religion, puisqu’il met l’amour et la non-puissance au-dessus de tout. à tel point que les chrétiens ont eu vite fait de le rendre plus conforme à l’esprit humain en le réinscrivant dans un cadre de pensée et des pratiques religieuses traditionnelles. La naissance de cette « religion chrétienne », et son incroyable dévoiement à partir du IVe siècle dans la confusion avec le pouvoir politique, est bien souvent aux antipodes du message dont elle s’inspire. L’église est nécessaire comme communauté de disciples qui a pour mission de transmettre la mémoire de Jésus et sa présence à travers le seul sacrement qu’il a institué (l’Eucharistie), de diffuser sa parole et surtout d’en témoigner. Mais comment reconnaître le message évangélique dans le droit canon, le décorum pompeux, un moralisme étroit, la hiérarchie ecclésiastique pyramidale, la multiplication des sacrements, la lutte sanglante contre les hérésies, l’emprise des clercs sur la société avec toutes les dérives que cela comporte ? La chrétienté, c’est la beauté sublime des cathédrales, mais c’est aussi tout cela. Prenant acte de la fin de notre civilisation chrétienne, un père du concile Vatican II s’est exclamé : « La chrétienté est morte, vive le christianisme ! » Paul Ricoeur, qui me rapportait cette anecdote quelques années avant sa mort, a ajouté : « Moi, j’aurais plutôt envie de dire : la chrétienté est morte, vive l’évangile !, puisqu’il n’y a jamais eu de société authentiquement chrétienne. » Au fond, le déclin de la religion chrétienne ne constitue-t-il pas une chance pour le message du Christ d’être à nouveau audible ? « On ne met pas du vin nouveau dans des outres vieilles », disait Jésus. La crise profonde des églises chrétiennes est peut-être le prélude à une nouvelle renaissance de la foi vive des évangiles. Une foi qui, parce qu’elle renvoie à l’amour du prochain comme signe de l’amour de Dieu, n’est pas sans une proximité forte avec l’humanisme laïque des droits de l’homme constituant le socle de nos valeurs modernes. Et une foi qui sera aussi une force de résistance farouche aux pulsions matérialistes et mercantiles d’un monde de plus en plus déshumanisé. Un nouveau visage du christianisme peut donc émerger sur les ruines de notre « civilisation chrétienne », dont les croyants attachés à l’évangile plus qu’à la culture et à la tradition chrétienne n’auront aucune nostalgie.
* Pourquoi le christianisme fait scandale (Seuil, 2010).
http://www.youtube.com/watch?v=fELBzF4iSg4 [...]
Le Monde des religions n° 42, juillet-août 2010 —
Il y a de quoi être étonné, surtout pour un sceptique, par la permanence des croyances et des pratiques astrologiques à travers toutes les cultures du monde. Depuis les plus anciennes civilisations, Chine et Mésopotamie, pas une aire culturelle importante qui n’ait vu la croyance astrale prospérer. Et alors qu’on la croyait moribonde en Occident depuis le XVIIe siècle et l’essor de l’astronomie scientifique, elle semble renaître de ses cendres depuis quelques décennies sous une double forme : populaire (horoscopes des journaux) et cultivée – la psycho-astrologie du thème astral qu’Edgar Morin n’hésite pas à définir comme une sorte de « nouvelle science du sujet ». Dans les civilisations antiques, astronomie et astrologie étaient confondues : l’observation rigoureuse de la voûte céleste (astronomie) permettait de prévoir des événements survenant sur Terre (astrologie). Cette mise en correspondance entre événements célestes (éclipses, conjonctions planétaires, comètes) et événements terrestres (famine, guerre, mort du roi) est au fondement même de l’astrologie. Même si elle repose sur des observations millénaires, l’astrologie n’a rien d’une science, au sens moderne du terme, puisque son fondement est indémontrable et sa pratique sujette à mille interprétations. Il s’agit donc d’une connaissance symbolique, qui repose sur la croyance qu’il existe une mystérieuse corrélation entre le macrocosme (le cosmos) et le microcosme (la société, l’individu). Dans la lointaine Antiquité, son succès tenait au besoin des empires de discerner et de prévoir en s’appuyant sur un ordre supérieur, le cosmos. La lecture des signes du ciel permettait de comprendre les avertissements envoyés par les dieux. D’une lecture politique et religieuse, l’astrologie va évoluer au fil des siècles vers une lecture plus individualisée et laïque. à Rome, au début de notre ère, on va consulter un astrologue pour savoir si telle opération médicale ou tel projet professionnel est opportun. Le renouveau moderne de l’astrologie révèle davantage le besoin de se connaître à travers un outil symbolique, le thème astral, censé révéler le caractère de l’individu et les grandes lignes de sa destinée. La croyance religieuse originelle est évacuée, mais pas celle dans le destin, puisque l’individu est censé naître à un moment précis où la voûte céleste manifesterait ses potentialités. Cette loi de correspondance universelle, qui permet ainsi de relier le cosmos à l’homme, est aussi le substrat même de ce qu’on appelle l’ésotérisme, sorte de courant religieux multiforme parallèle aux grandes religions, qui tire ses racines en Occident du stoïcisme (l’âme du monde), du néoplatonisme et de l’hermétisme antique. Le besoin moderne de se relier au cosmos participe à ce désir de « réenchantement du monde », typique de la post-modernité. Lorsqu’astronomie et astrologie se sont séparées au XVIIe siècle, la plupart des penseurs étaient persuadés que la croyance astrologique allait définitivement disparaître comme une superstition de bonne femme. Une voix discordante s’est fait entendre : celle de Johannes Kepler, l’un des pères fondateurs de la science astronomique moderne, qui continua de faire des thèmes astraux en expliquant qu’il ne fallait pas chercher à donner une explication rationnelle à l’astrologie, mais se borner à constater son efficacité pratique. Force est aujourd’hui de constater que l’astrologie connaît non seulement un certain regain en Occident, mais continue d’être pratiquée dans la plupart des sociétés asiatiques, répondant ainsi à un besoin aussi vieux que l’humanité : trouver du sens et de l’ordre au sein d’un monde si imprévisible et apparemment chaotique.
Je remercie très vivement nos amis Emmanuel Leroy Ladurie et Michel Cazenave pour tout ce qu’ils ont apporté à travers leurs chroniques dans notre journal pendant des années. Ils transmettent le relais à Rémi Brague et à Alexandre Jollien, que nous accueillons avec grand plaisir.
http://www.youtube.com/watch?v=Yo3UMgqFmDs&feature=player_embedded [...]
Le Monde des religions n° 41, mai-juin 2010 —
Parce qu’elle est primordiale dans toute existence humaine, la question du bonheur est au cœur des grandes traditions philosophiques et religieuses de l’humanité.
Son retour en force dans nos sociétés occidentales, en ce début de XXIe siècle, tient à l’effondrement des grandes idéologies et des utopies politiques qui entendaient faire le bonheur de l’humanité.
Le capitalisme pur et dur a échoué autant que le communisme ou le nationalisme comme système collectif de sens. Restent donc les quêtes personnelles, qui permettent à des individus de tenter de mener une existence heureuse. D’où le regain d’intérêt pour les philosophies antiques et orientales, ainsi que le développement dans les religions monothéistes de courants, comme le mouvement évangélique dans le monde chrétien, qui mettent l’accent sur le bonheur terrestre, et non plus seulement dans l’au-delà.
A la lecture des nombreux points de vue exprimés dans ce dossier par les grands sages et maîtres spirituels de l’humanité, on ressent une tension permanente, qui dépasse la diversité culturelle, entre deux conceptions du bonheur. D’un côté, le bonheur est recherché comme un état stable, définitif, absolu. C’est le Paradis promis dans l’au-delà, dont on peut avoir un avant-goût ici-bas en menant une vie sainte.
C’est aussi la quête des sages bouddhistes ou stoïciens, qui vise à acquérir un bonheur durable ici et maintenant, au-delà de toutes les souffrances de ce monde. Le paradoxe d’une telle quête, c’est qu’elle est théoriquement offerte à tous, mais qu’elle exige une ascèse et un renoncement aux plaisirs ordinaires que bien peu d’individus sont prêts à vivre.
A l’autre extrême, le bonheur est présenté comme aléatoire, nécessairement provisoire et, tout compte fait, assez injuste puisqu’il dépend beaucoup du caractère de chacun : comme le rappelle Schopenhauer, à la suite d’Aristote, le bonheur réside dans l’accomplissement de notre potentiel et il existe de fait une inégalité radicale du tempérament de chaque individu. Le bonheur, comme le signifie son étymologie, doit donc à la chance: “bonne heure”.
Et le mot grec eudaimonia renvoie au fait d’avoir un bon daîmon. Mais au-delà de cette diversité de points de vue, quelque chose s’entend chez nombre de sages de tous courants, auquel je souscris pleinement: le bonheur a surtout à voir avec un juste amour de soi et de la vie. Une vie que l’on accepte comme elle se présente, avec son lot de joie et de tristesse, en essayant de faire reculer le malheur autant que possible, mais sans fantasme écrasant de bonheur absolu. Une vie que l’on aime en commençant par s’accepter et s’aimer soi-même tel que l’on est, dans une « amitié » pour soi-même comme l’a prôné Montaigne. Une vie qui doit être appréhendée avec souplesse, dans l’accompagnement de son mouvement permanent, à l’image de la respiration, comme le rappellent les sagesses chinoises. Le meilleurs moyen d’être le plus heureux possible, c’est de dire « oui » à la vie.
Voir la vidéo :
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer [...]
Le Monde des religions n° 40, mars-avril 2010 —
La décision de Benoît XVI de poursuivre le procès de béatification du pape Pie XII suscite une vaste polémique, qui divise autant le monde juif que le monde chrétien. Le président de la communauté rabbinique de Rome a boycotté la visite du pape dans la grande synagogue de Rome, afin de protester contre l’attitude “passive” de Pie XII face au drame de l’Holocauste.
Benoît XVI a une nouvelle fois justifié le choix de canoniser son prédécesseur, arguant qu’il ne pouvait pas condamner plus ouvertement les atrocités commises par le régime nazi sans faire courir le risque de représailles envers les catholiques, dont les Juifs, nombreux à être cachés dans les couvents, auraient été les premières victimes. L’argument est tout à fait fondé. L’historien Léon Poliakov l’avait déjà souligné en 1951, dans la première édition du Bréviaire de la haine, le IIIe Reich et les Juifs : “Il est pénible de constater que tout le long de la guerre, tandis que les usines de la mort tournaient tous fours allumés, la papauté gardait le silence. Il faut toutefois reconnaître qu’ainsi que l’expérience l’a montré à l’échelle locale, des protestations publiques pouvaient être immédiatement suivies de sanctions impitoyables.”
Pie XII, en bon diplomate, a tenté de ménager la chèvre et le chou : il a soutenu secrètement les Juifs, sauvant directement la vie de milliers de Juifs romains après l’occupation de l’Italie du Nord par les Allemands, tout en évitant une condamnation directe de l’Holocauste, afin de ne pas rompre tout dialogue avec le régime nazi et d’éviter une réaction brutale. Cette attitude peut être qualifiée de responsable, de rationnelle, de prudente, voire de sage. Mais elle n’a rien de prophétique et ne traduit pas les agissements d’un saint. Jésus est mort sur la croix pour avoir été fidèle jusqu’au bout à son message d’amour et de vérité.
A sa suite, les apôtres Pierre et Paul ont donné leur vie parce qu’ils n’ont pas renoncé à annoncer le message du Christ ou à l’ajuster aux circonstances pour « des raisons diplomatiques ». Imaginons qu’ils aient été papes à la place de Pie XII ? On les imagine mal composer avec le régime nazi, mais bien plutôt décider de mourir déportés avec ces millions d’innocents. Voilà l’acte de sainteté, de portée prophétique que, dans des circonstances aussi tragiques de l’histoire, on pouvait attendre du successeur de Pierre. Un pape qui donne sa vie et qui dise à Hitler : “Je préfère mourir avec mes frères juifs plutôt que cautionner cette abomination.”
Certes, les représailles auraient été terribles pour les catholiques, mais l’église aurait envoyé un message d’une force inouïe au monde entier. Les premiers chrétiens étaient saints parce qu’ils mettaient leur foi et l’amour du prochain au-dessus de leur propre vie. Pie XII sera canonisé parce que c’était un homme pieux, un bon gestionnaire de la curie romaine et un fin diplomate. C’est tout l’écart qui existe entre l’église des martyrs et l’église post-constantinienne, davantage préoccupée de préserver son poids politique que de témoigner de l’évangile.
Enregistrer
Enregistrer [...]
Le Monde des religions n° 39, janvier-février 2010 —
Près de quatre siècles après la condamnation de Galilée, le débat public sur le thème de la science et de la religion semble toujours polarisé par deux extrêmes. D’un côté, le délire créationniste, qui entend nier certains acquis incontournables de la science, au nom d’une lecture fondamentaliste de la Bible. De l’autre, le retentissement médiatique d’ouvrages de certains scientifiques, tels Richard Dawkins (Pour en finir avec Dieu, Robert Laffont, 2008), qui entendent prouver la non-existence de Dieu à l’aide d’arguments scientifiques. Pourtant, ces positions sont assez marginales dans les deux camps. En Occident, une grande majorité de croyants admet la légitimité de la science et la plupart des scientifiques affirment que jamais la science ne pourra prouver l’existence ou la non-existence de Dieu. Au fond, et pour reprendre une expression de Galilée lui-même, on admet que science et religion répondent à deux questions d’un ordre radicalement différents, qui ne sauraient rentrer en conflit : « L’intention du Saint Esprit est de nous enseigner comment on doit aller au ciel, et non comment va le ciel. » Au XVIIIe siècle, Kant rappellera la distinction entre foi et raison, et l’impossibilité pour la raison pure de répondre à la question de l’existence de Dieu. Né dans la seconde moitié du XIXe siècle, le scientisme deviendra pourtant une véritable « religion de la raison », annonçant de manière récurrente la mort de Dieu grâce aux victoires de la science. Richard Dawkins en est l’un des derniers avatars. Le créationnisme est également né dans la seconde moitié du XIXe siècle, en réaction à la théorie darwinienne de l’évolution. à sa version biblique fondamentaliste, a succédé une version beaucoup plus douce, qui admet la théorie de l’évolution, mais qui entend prouver par la science l’existence de Dieu à travers la théorie du dessein intelligent (intelligent design). Thèse plus audible, mais qui retombe dans l’ornière de la confusion entre démarche scientifique et démarche religieuse.
Si l’on admet cette distinction des savoirs, qui me paraît être un acquis fondamental de la pensée philosophique, doit-on affirmer pour autant qu’il n’existe aucun dialogue possible entre science et religion ? Et de manière plus large, entre une vision scientifique et une conception spirituelle de l’homme et du monde ?
Le dossier de ce numéro donne la parole à des scientifiques de renommée internationale qui appellent à un tel dialogue. Ce ne sont en effet pas tant des religieux que des hommes de science qui sont de plus en plus nombreux à prôner un nouveau dialogue entre science et spiritualité. Cela tient pour une grande part à l’évolution de la science elle-même au cours du siècle dernier. à partir de l’étude de l’infiniment petit (monde subatomique), les théories de la mécanique quantique ont montré que la réalité matérielle était beaucoup plus complexe, profonde et mystérieuse qu’on ne pouvait l’imaginer selon les modèles de la physique classique héritée de Newton. à l’autre extrême, celui de l’infiniment grand, les découvertes en astrophysique sur les origines de l’univers, et notamment la théorie du Big Bang, ont balayé les théories d’un univers éternel et statique, sur lesquels s’appuyaient nombre de savants pour affirmer l’impossibilité d’un principe créateur. Dans une moindre mesure, les recherches sur l’évolution de la vie et sur la conscience tendent aujourd’hui à relativiser les visions scientistes du « hasard qui explique tout » et de « l’homme neuronal ». Dans la première partie de ce dossier, des scientifiques font part à la fois des faits – ce qui a changé en science depuis un siècle – et de leur propre opinion philosophique : pourquoi la science et la spiritualité peuvent dialoguer de manière féconde dans le respect de leur méthode respective. Allant plus loin encore, d’autres chercheurs, dont deux Nobel, apportent ensuite leur propre témoignage de scientifiques et de croyants, et disent les raisons qui leur font penser que science et religion, loin de s’opposer, tendent plutôt à converger. La troisième partie du dossier donne la parole à des philosophes : que pensent-ils de ce nouveau paradigme scientifique et du discours de ces chercheurs qui prônent un nouveau dialogue, voire une convergence, entre science et spiritualité ? Quels sont les perspectives et les limites méthodologiques d’un tel dialogue ? Au-delà des polémiques stériles et émotionnelles, ou, à l’inverse, des rapprochements superficiels, voilà des questionnements et des débats qui me semblent essentiels à une meilleure compréhension du monde et de nous-mêmes.
Enregistrer
Enregistrer [...]
Le Monde des religions, novembre-décembre 2009 —
Les religions font peur. De nos jours, la dimension religieuse est présente, à des degrés divers, dans la plupart des conflits armés. Sans même parler de guerre, les polémiques autour des questions religieuses sont parmi les plus violentes au sein des pays occidentaux. Assurément, la religion divise plus qu’elle n’unit les hommes. Pourquoi ? Dès l’origine, la religion possède pourtant une double dimension de lien. De manière verticale, elle crée du lien entre les hommes et un principe supérieur, quel que soit le nom qu’on lui donne : esprit, dieu,
Absolu. C’est sa dimension mystique. De manière horizontale, elle rassemble des êtres humains, qui se sentent unis par cette croyance commune en cette transcendance invisible. C’est sa dimension politique. C’est ce qu’exprime bien
l’étymologie latine du mot « religion » : religere, « relier ». Un groupe humain est soudé par des croyances partagées et celles-ci sont d’autant plus fortes, comme Régis Debray l’a fort bien expliqué, qu’elles renvoient à un absent, à une force invisible. La religion revêt dès lors une dimension identitaire éminente : chaque individu se sent appartenir à un groupe par cette dimension religieuse qui constitue aussi une part importante de son identité personnelle. Tout va bien lorsque tous les individus partagent les mêmes croyances. La violence commence lorsque certains individus sortent de la norme commune : c’est l’éternelle persécution des « hérétiques » et des « infidèles », qui menacent la cohésion sociale du groupe. La violence s’exerce aussi, bien sûr, à l’extérieur de la communauté, envers les autres cités, groupes ou nations qui ont d’autres croyances. Et même lorsque le pouvoir politique est séparé du pouvoir religieux, la religion est souvent instrumentalisée par le politique à cause de sa dimension identitaire mobilisatrice. On se souvient de Saddam Hussein, incroyant et chef d’un état laïque, en appelant au djihad pour lutter contre les « croisés juifs et chrétiens » lors des deux guerres du Golfe. L’enquête que nous avons réalisée dans les colonies israéliennes en donne un autre exemple. Dans un monde qui se globalise rapidement, suscitant peurs et rejets, la religion connaît partout un regain identitaire. On a peur de l’autre, on se replie sur soi et sur ses racines culturelles en secrétant de l’intolérance. Il existe pourtant une tout autre attitude possible pour les croyants : rester fidèles à leurs racines, tout en étant capables de s’ouvrir et de dialoguer avec l’autre dans sa différence. Refuser que la religion soit utilisée par le politique à des fins belliqueuses. Revenir aux fondements verticaux de chaque religion, qui prône des valeurs de respect d’autrui, de paix, d’accueil de l’étranger. Vivre la religion dans sa dimension spirituelle plus qu’identitaire. En s’appuyant sur ce patrimoine commun de valeurs spirituelles et humanistes plutôt que sur la diversité des cultures et des dogmes qui les divisent, les religions peuvent jouer un rôle pacificateur au plan planétaire. On en est encore très loin, mais beaucoup d’individus et de groupes oeuvrent en ce sens : c’est aussi utile de le rappeler. Si, pour reprendre la formule de Péguy, « tout commence en mystique et finit en politique », il n’est pas impossible aux croyants de travailler à l’édification d’un espace politique mondial pacifié, par le fond mystique commun des religions : le primat de l’amour, de la miséricorde et du pardon. C’est-à-dire oeuvrer à l’avènement d’un monde fraternel. Les religions ne me semblent donc pas constituer un obstacle irréversible à un tel projet, qui rejoint celui des humanistes, qu’ils soient croyants, athées ou agnostiques. [...]
Le Monde des religions, septembre-octobre 2009 —
La France est le pays européen qui compte le plus de musulmans. Or le développement rapide de l’islam au pays de Pascal et de Descartes aux cours des dernières décennies suscite peurs et interrogations. Ne parlons pas du discours fantasmatique de l’extrême-droite, qui tente d’activer ces peurs en prophétisant un bouleversement de la société française sous la « pression d’une religion appelée à devenir majoritaire ». Plus sérieusement, certaines inquiétudes sont tout à fait légitimes : comment concilier notre tradition laïque, qui renvoie la religion dans la sphère privée, avec de nouvelles revendications religieuses spécifiques à l’école, à l’hôpital, dans les lieux publics ? Comment concilier notre vision d’une femme émancipée avec la montée d’une religion aux signes identitaires forts, tel le fameux foulard – sans parler du voile intégral -, qui évoquent pour nous la soumission de la femme au pouvoir masculin ? Il y a bel et bien un choc culturel et un conflit de valeurs qu’il serait dangereux de nier. Mais s’interroger, ou émettre des critiques, ne signifie pas pour autant transmettre des préjugés et stigmatiser dans une attitude défensive, mue par la peur de l’autre et de sa différence. C’est pourquoi Le Monde des Religions a voulu consacrer un grand dossier exceptionnel de 36 pages aux musulmans français et la question de l’islam en France. Cette question se pose concrètement depuis deux siècles avec l’arrivée des premiers émigrés et s’enracine même dans notre imaginaire depuis plus de douze siècles avec les guerres contre les Sarrasins et la fameuse bataille de Poitiers. Aussi est-il nécessaire de porter un regard historique sur la question pour mieux apprécier les peurs, les préjugés et les jugements de valeurs que nous portons sur la religion de Mohammed (et non
« Mahomet », comme l’écrivent les médias, sans savoir qu’il s’agit d’une dénomination turcophone du Prophète héritée de la lutte contre l’empire ottoman). Nous avons ensuite tenté d’explorer la galaxie des musulmans français à travers des reportages sur cinq grands groupes très divers (et non exclusifs) : les anciens immigrés algériens venus travailler en France à partir de 1945 ; les jeunes musulmans français qui mettent au premier plan leur identité religieuse ; ceux qui, tout en assumant une identité musulmane, entendent d’abord la passer au crible de la raison critique et des valeurs humanistes héritées des Lumières ; ceux qui ont pris leur distance avec l’islam comme religion ; et ceux enfin qui sont dans la mouvance fondamentaliste salafiste. Cette mosaïque d’identités révèle l’extrême complexité d’une question fortement émotionnelle et politiquement très sensible. à tel point que les pouvoirs publics refusent d’utiliser les
appartenances religieuses et ethniques pour les recensements, ce qui permettrait pourtant de mieux cerner les Français musulmans et de connaître leur nombre. Il nous a ainsi semblé utile de clore ce dossier par des articles de décryptage sur les rapports entre l’islam et la République, ou la question de l’« islamophobie», et de donner la parole à plusieurs universitaires ayant une vision distanciée.
L’islam est la deuxième religion de l’humanité en nombre de fidèles après le christianisme. C’est aussi la deuxième religion de France, loin derrière le catholicisme, mais loin devant le protestantisme, le judaïsme et le bouddhisme. Quelle que soit l’opinion que l’on ait de cette religion, c’est un fait. L’un des plus grands défis de notre société est de travailler à la meilleure harmonisation possible de l’islam avec la tradition culturelle et politique française. Cela ne pourra pas se faire, pour les musulmans comme pour les non-musulmans, dans un climat d’ignorance, de défiance ou d’agressivité… [...]
Le Monde des religions, juillet-août 2009 —
Nous sommes plongés dans une crise économique d’une ampleur rare, qui devrait remettre en cause notre modèle de développement, fondé sur une croissance permanente de la production et de la consommation. Le mot « crise » en grec signifie « décision », « jugement », et renvoie à l’idée d’un moment charnière où « ça doit se décider ». Nous traversons une période cruciale où des choix fondamentaux doivent être faits, sans quoi le mal ne fera qu’empirer, cycliquement peut-être, mais sûrement.
Comme nous le rappellent Jacques Attali et André Comte-Sponville dans le passionnant dialogue qu’ils nous ont accordé, ces choix doivent être politiques, à commencer par un nécessaire assainissement et un encadrement plus efficace et plus juste du système financier aberrant dans lequel nous vivons aujourd’hui. Ils peuvent aussi concerner plus directement l’ensemble des citoyens, par une réorientation de la demande vers l’achat de biens plus écologiques et plus solidaires. La sortie durable de la crise dépendra certainement d’une vraie détermination à changer les règles du jeu financier et nos habitudes de consommation. Mais ce ne sera sans doute pas suffisant. Ce sont nos modes de vie, fondés sur une croissance constante de la consommation qu’il faudra modifier.
Depuis la révolution industrielle, et plus encore depuis les années 1960, nous vivons en effet dans une civilisation qui fait de la consommation le moteur du progrès. Moteur non seulement économique, mais aussi idéologique : le progrès, c’est posséder plus. Omniprésente dans nos vies, la publicité ne fait que décliner cette croyance sous toutes ses formes. Peut-on être heureux sans avoir la voiture dernier cri ? Le dernier modèle de lecteur DVD ou de téléphone portable ? Une télévision et un ordinateur dans chaque pièce ? Cette idéologie n’est pour ainsi dire presque jamais remise en cause : tant que c’est possible, pourquoi pas ? Et la plupart des individus à travers la planète lorgnent aujourd’hui vers ce modèle occidental, qui fait de la possession, de l’accumulation et du changement permanent des biens matériels le sens ultime de l’existence. Lorsque ce modèle se grippe, que le système déraille ; lorsqu’il apparaît qu’on ne pourra sans doute pas continuer à consommer indéfiniment à ce rythme effréné, que les ressources de la planète sont limitées et qu’il devient urgent de partager ; on peut enfin se poser les bonnes questions. On peut s’interroger sur le sens de l’économie, sur la valeur de l’argent, sur les conditions réelles de l’équilibre d’une société et du bonheur individuel.
En cela, je crois que la crise peut et se doit d’avoir un impact positif. Elle peut nous aider à refonder notre civilisation, devenue pour la première fois planétaire, sur d’autres critères que l’argent et la consommation. Cette crise n’est pas simplement économique et financière, mais aussi philosophique et spirituelle. Elle renvoie à des interrogations universelles : qu’est-ce qui peut être considéré comme un progrès véritable ? L’être humain peut-il être heureux et vivre en harmonie avec autrui dans une civilisation entièrement construite autour d’un idéal de l’avoir ? Sans doute pas. L’argent et l’acquisition de biens matériels ne sont que des moyens, certes précieux, mais jamais une fin en soi. Le désir de possession est, par nature, insatiable. Et il engendre de la frustration et de la violence. L’être humain est ainsi fait qu’il désire sans cesse posséder ce qu’il n’a pas, quitte à le prendre par la force chez son voisin. Or, une fois ses besoins matériels essentiels assurés – se nourrir, avoir un toit et de quoi vivre décemment -, l’homme a besoin d’entrer dans une autre logique que celle de l’avoir pour être satisfait et devenir pleinement humain : celle de l’être. Il doit apprendre à se connaître et à se maîtriser, à appréhender le monde qui l’entoure et à le respecter. Il doit découvrir comment aimer, comment vivre avec les autres, gérer ses frustrations, acquérir la sérénité, surmonter les souffrances inévitables de la vie, mais aussi se préparer à mourir les yeux ouverts. Car si l’existence est un fait, vivre est un art. Un art qui s’apprend, en interrogeant les sages et en travaillant sur soi. [...]
Le Monde des religions, mai-juin 2009 —
L’excommunication prononcée par l’archevêque de Recife à l’encontre de la mère et de l’équipe médicale qui ont fait avorter la fillette brésilienne de 9 ans, violée et enceinte de jumeaux, a suscité un tollé dans le monde catholique. De nombreux fidèles, des prêtres et même des évêques ont exprimé leur indignation face à cette mesure disciplinaire, qu’ils jugent excessive et inappropriée. J’ai moi aussi réagi vivement, soulignant la contradiction flagrante entre cette condamnation brutale et dogmatique, et le message évangélique qui prône la miséricorde, l’attention aux personnes et le dépassement de la loi par l’amour. Une fois l’émotion passée, il me semble important de revenir sur cette affaire, non pas pour en rajouter dans l’indignation, mais pour tenter d’analyser avec recul le problème de fond qu’elle révèle pour l’église catholique.
Face à l’émotion suscitée par cette décision, la conférence épiscopale brésilienne a tenté de minimiser cette excommunication et d’y soustraire la mère de la fillette, sous prétexte qu’elle aurait été influencée par l’équipe médicale. Mais le cardinal Batista Re, préfet de la congrégation des évêques, a été beaucoup plus clair en expliquant que l’archevêque de Recife n’a finalement fait que rappeler le droit canonique. Or celui-ci stipule que toute personne qui pratique l’avortement se met de facto hors de la communion de l’église : « Qui procure un avortement, si l’effet s’en suit, encourt l’excommunication latae sententiae » (Canon 1398). Nul n’a besoin de l’excommunier officiellement : il s’est excommunié lui-même par son acte. Certes, l’archevêque de Recife aurait pu ne pas en rajouter en rappelant haut et fort le droit canon, suscitant ainsi une polémique mondiale, mais cela ne règle en rien le problème de fond qui a scandalisé tant de fidèles : comment une loi chrétienne – qui, par ailleurs, ne considère pas le viol comme un acte suffisamment grave pour justifier une excommunication – peut-elle condamner des personnes qui tentent de sauver la vie d’une petite fille violée en la faisant avorter ? Il est normal qu’une religion ait des règles, des principes, des valeurs, et qu’elle s’attache à les défendre. On peut comprendre, en l’occurrence, que le catholicisme, comme toutes les religions, soit hostile à l’avortement. Mais faut-il inscrire cette interdiction dans un droit intangible, qui prévoit des mesures disciplinaires automatiques, faisant fi de la diversité des cas concrets ? En cela, l’église catholique se distingue des autres religions et des autres confessions chrétiennes, qui n’ont pas d’équivalent du droit canonique, hérité du droit romain, et de ses mesures disciplinaires. Elles condamnent par principe certains actes, mais elles savent aussi s’adapter à chaque situation particulière et considérer que la transgression de la norme constitue parfois un « moindre mal ». C’est si évident dans le cas de cette fillette brésilienne. L’abbé Pierre disait la même chose à propos du sida : mieux vaut lutter contre le risque de transmission de la maladie par la chasteté et la fidélité, mais pour ceux qui n’y arrivent pas, mieux vaut mettre un préservatif que de transmettre la mort. Et il faut d’ailleurs rappeler, comme l’ont fait plusieurs évêques français, que les pasteurs de l’église pratiquent au quotidien cette théologie du « moindre mal », en s’adaptant aux cas particuliers et en accompagnant les personnes en difficulté avec miséricorde, ce qui les conduit à faire souvent des entorses à la règle. Agissant ainsi, ils ne font que mettre en oeuvre le message évangélique : Jésus condamne en soi l’adultère, mais pas la femme prise en flagrant délit d’adultère, que les zélateurs de la loi religieuse veulent lapider, et auxquels il lance cette parole sans appel : « Que celui qui n’a jamais péché lui jette la première pierre » (Jean, 8). Une communauté chrétienne qui entend être fidèle au message de son fondateur, tout comme rester audible dans un monde de plus en plus sensible à la souffrance et à la complexité de chaque individu, peut-elle continuer d’appliquer ainsi des mesures disciplinaires sans discernement ? Ne doit-elle pas rappeler, en même temps que l’idéal et la norme, la nécessité de s’adapter à chaque cas concret ? Et surtout témoigner que l’amour est plus fort que la loi ? [...]
Le Monde des religions, mars-avril 2009 —
La crise déclenchée par la décision de Benoît XVI de lever l’excommunication qui frappait les quatre évêques ordonnés par Mgr Lefebvre en 1988 est loin d’être close. Que le pape fasse son métier en tentant de réintégrer dans le giron de l’Église des schismatiques qui le demandent, nul ne saurait le lui reprocher. Le trouble vient d’ailleurs. Il y eut bien sûr le télescopage de cette annonce avec la publication des propos négationnistes odieux de l’un d’entre eux, Mgr Williamson. Que la curie romaine n’ait pas cru bon d’informer le pape des positions de cet extrémiste, connues des cercles avertis depuis novembre 2008, n’est déjà pas bon signe. Que Benoît XVI n’ait pas assorti la levée d’excommunication (publiée le 24 janvier) d’une condition de demande immédiate de rétractation de tels propos (connues de tous le 22 janvier) et qu’il ait fallu attendre une semaine pour que le pape tienne un discours ferme sur la question est aussi inquiétant. Non pas que l’on puisse le soupçonner de connivence avec les antisémites intégristes – il a redit très clairement le 12 février que « l’Eglise est profondément et irrévocablement engagée dans le rejet de l’antisémitisme » – mais ses atermoiements ont donné le sentiment qu’il avait fait de la réintégration des intégristes une priorité absolue, presque aveuglante, se refusant à voir à quel point la plupart de ces irréductibles sont encore enfermés dans des points de vue totalement opposés à l’Église issue du concile Vatican II.
En levant l’excommunication et en entamant un processus d’intégration qui devait donner à la fraternité Saint-Pie X un statut particulier au sein de l’Église, le pape estimait sans doute que les derniers disciples de Mgr Lefebvre finiraient par changer et admettre l’ouverture au monde prôné par le concile Vatican IL Les intégristes pensaient exactement le contraire. Mgr Tissier de Mallerais, l’un des quatre évêques ordonnés par Mgr Lefebvre, déclarait quelques jours après la levée de l’excommunication dans une interview au journal italien La Stampa : « Nous ne changerons pas nos positions, mais nous avons l’intention de convertir Rome, c’est-à-dire d’amener le Vatican vers nos positions. » Le même prélat affirmait six mois plus tôt, dans la revue américaine The Angélus, que la priorité de la fraternité Saint-Pie X était « notre persévérance à refuser les erreurs du concile Vatican II » et prédisait l’avènement de « républiques islamiques » en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne ou aux Pays-Bas ; et à Rome, la fin du catholicisme, une « apostasie organisée avec la religion juive ». La fraternité Saint-Pie X est aujourd’hui au bord de l’implosion, tant les positions divergent sur la meilleure stratégie à adopter vis-à-vis de Rome. Une chose est certaine, la plupart de ces extrémistes sectaires n’entendent pas renoncer à ce qui fonde leur identité et leur combat depuis quarante ans : refuser les principes d’ouverture au monde, de liberté religieuse et de dialogue avec les autres religions prônées par le concile. Comment le pape peut-il d’un côté vouloir à tout prix inclure ces fanatiques dans l’Eglise, et en même temps poursuivre le dialogue avec les autres confessions chrétiennes et les religions non-chrétiennes ? Jean Paul II avait eu la lucidité de choisir sans ambiguïté, et c’est d’ailleurs la rencontre d’Assise, en 1986, avec les autres religions qui avait été la goutte d’eau incitant Mgr Lefebvre à rompre avec Rome. Depuis son élection, Benoît XVI a multiplié les gestes envers les intégristes et ne cesse de faire reculer le dialogue œcuménique et interreligieux. On comprend que le malaise soit grand chez les très nombreux catholiques, y compris les évêques, attachés à l’esprit de dialogue et de tolérance d’un concile qui entendait rompre, une fois pour toutes, avec l’esprit antimoderne du catholicisme intransigeant, refusant en bloc la laïcité, l’œcuménisme, la liberté de conscience et les droits de l’homme.
Pour fêter ses cinq ans d’existence, Le Monde des Religions vous propose une nouvelle formule, qui fait évoluer le journal tant sur la forme (nouvelle maquette, davantage d’illustrations) que dans le fond : dossier plus copieux avec des renvois bibliographiques, davantage de philosophie sous la houlette d’André Comte-Sponville, nouveau chemin de fer – les sections « Histoire » et « Spiritualité » font place aux sections « Savoir » et « Vécu » – et nouvelles rubriques: « Dialogue interreligieux », « 24 heures dans la vie de… », « 3 clés pour comprendre la pensée de… », « L’artiste et le sacré » ; une nouvelle chronique littéraire de Leili Anvar ; plus de pages consacrées à l’actualité culturelle liée à la religion (cinéma, théâtre, expositions). [...]
Le Monde des religions, janvier-février 2009 —
Il y a moins de points communs que l’on ne s’imagine entre les diverses religions du monde. Il y a surtout la fameuse règle d’or, déclinée de mille manières : ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu’on te fasse. Il en est un autre, en contradiction flagrante avec ce principe, qui surprend par son ancienneté, sa permanence et sa quasi-universalité : le mépris de la femme. Comme si la femme était un être humain potentiel ou raté, assurément inférieur au sexe masculin. Les éléments historiques et textuels que nous apportons dans le dossier de ce numéro pour étayer ce triste constat sont par trop éloquents. Pourquoi un tel mépris ? Les motifs psychologiques sont sans doute déterminants. Comme le rappelle Michel Cazenave à la suite des pionniers de la psychanalyse, l’homme est à la fois jaloux de la jouissance féminine et effrayé par son propre désir de la femme. La sexualité est sans doute au cœur du problème, et les mâles islamiques qui ne tolèrent les femmes que voilées n’ont rien à envier aux Pères de l’Eglise, qui ne voyaient dans la femme qu’une tentatrice en puissance. Il existe aussi des raisons socio-historiques à cet abaissement de la femme dans presque toutes les cultures, un abaissement auquel les religions ont contribué de manière déterminante. Le culte très ancien de la « grande déesse » témoigne d’une valorisation du principe féminin. Les chamanes des religions premières de l’humanité sont de sexe masculin ou féminin, à l’image des esprits qu’ils vénèrent, comme en témoignent les sociétés orales qui ont survécu jusqu’à nos jours. Mais il y a quelques millénaires, lorsque les cités se sont développées et que les premiers royaumes se sont constitués, la nécessité d’une organisation sociale s’est fait sentir et une administration politique et religieuse est apparue. Or ce sont les hommes qui se sont attribué les rôles de gouvernement. Les prêtres chargés d’administrer les cultes se sont empressés de masculiniser le panthéon, et les dieux mâles, à l’image de ce qui se passait sur terre, ont pris le pouvoir au ciel. Les monothéismes n’ont, à leur tour, fait que reproduire et parfois même amplifier ce schéma polythéiste en donnant au dieu unique un visage exclusivement masculin. Grand paradoxe des religions depuis des millénaires : si méprisée, la femme en est souvent le véritable cœur ; elle prie, transmet, compatit aux souffrances d’autrui. Aujourd’hui, les mentalités évoluent grâce à la sécularisation des sociétés modernes et à l’émancipation des femmes qu’elle a favorisée. Malheureusement, certaines pratiques terrifiantes – ces quinze adolescentes afghanes récemment aspergées d’acide tandis qu’elles se rendaient à leur école de Kandahar – ainsi que des propos d’un autre âge – comme ceux prononcés par l’archevêque de Paris : « II ne suffit pas d’avoir des jupes, encore faut-il avoir des choses dans la tête » – montrent que beaucoup de chemin reste à parcourir pour que les traditions religieuses reconnaissent enfin la femme comme l’égale de l’homme, et gomment de leurs doctrines et de leurs pratiques ces traces séculaires de misogynie. [...]
Le Monde des religions, novembre-décembre 2008 —
A l’occasion des 40 ans de l’encyclique Humanae Vitae, Benoît XVI a rappelé avec fermeté l’opposition de l’Église catholique à la contraception, à l’exception de « l’observation des rythmes naturels de la fertilité de la femme », lorsque le couple traverse des « circonstances graves », justifiant un espacement des naissances. Des propos qui ont naturellement suscité un concert de critiques soulignant une nouvelle fois le déphasage entre la doctrine morale de l’Église et l’évolution des mœurs. Ce déphasage ne me paraît pas constituer en soi un reproche justifié. L’Eglise n’est pas une entreprise qui doit vendre son message à tout prix. Le fait que son discours soit en décalage avec l’évolution de nos sociétés peut être aussi le signe salutaire d’une résistance à l’esprit du temps. Le pape n’est pas là pour bénir la révolution des mœurs, mais pour défendre certaines vérités auxquelles il croit, quitte à perdre des fidèles. La véritable critique qu’on peut apporter à cette condamnation de la contraception porte sur l’argument qui la justifie. Benoît XVI l’a rappelé : exclure la possibilité de donner la vie « au moyen d’une action visant à empêcher la procréation » revient à « nier la vérité intime de l’amour conjugal ». En liant de manière indissoluble l’amour des époux à la procréation, le magistère de l’Église reste conforme à une vieille tradition catholique remontant à saint Augustin, qui se méfie de la chair et du plaisir charnel, et ne conçoit finalement les relations sexuelles que dans la perspective de la reproduction. À ce compte, un couple stérile peut-il être dans la vérité de l’amour ? Or rien dans les Évangiles ne vient corroborer une telle interprétation et il existe dans les autres traditions chrétiennes, notamment orientales, un tout autre regard sur l’amour et la sexualité humaine. Il y a donc ici un problème théologique de fond qui mériterait d’être entièrement repensé, non pas à cause de l’évolution des mœurs, mais d’une vision éminemment contestable de la sexualité et de l’amour des époux. Sans parler bien entendu des conséquences sociales souvent dramatiques que peut avoir un tel discours dans des populations pauvres, où la contraception est souvent le seul moyen efficace de lutter contre l’accroissement de la paupérisation. Des religieux eux-mêmes, tels l’abbé Pierre et sœur Emmanuelle – une jeune centenaire à qui je souhaite un joyeux anniversaire ! -, avaient tous deux écrit à Jean Paul II en ce sens. Ce sont sans doute pour ces raisons profondes, et non pas seulement à cause de la révolution des mœurs, que de nombreux catholiques ont déserté les églises depuis 1968. Comme l’a dit récemment le cardinal Etchegaray, Humanae Vitae a constitué en son temps un « schisme silencieux », tant nombre de fidèles ont été choqués par la vision de la vie conjugale véhiculée par l’encyclique papale. Ces catholiques déçus ne sont pas des couples libertins, prônant une sexualité débridée, mais des croyants qui s’aiment et qui ne comprennent pas pourquoi la vérité de l’amour de leur couple serait dissoute par une vie sexuelle dissociée du projet d’enfant. Hormis les franges les plus extrémistes, aucune autre confession chrétienne et même aucune autre religion ne tiennent un tel discours. Pourquoi l’Église catholique a-t-elle encore aussi peur du plaisir charnel ? On peut comprendre que l’Église rappelle le caractère sacré du don de la vie. Mais la sexualité, vécue dans un amour authentique, ne constitue-t-elle pas aussi une expérience du sacré ? [...]
Le Monde des religions, septembre-octobre 2008 —
Comme son nom l’indique, la Déclaration des droits de l’homme se veut universelle, c’est-à-dire qu’elle entend s’appuyer sur un fondement naturel et rationnel qui transcende toutes les considérations culturelles particulières : quels que soient leur lieu de naissance, leur sexe ou leur religion, tous les êtres humains ont droit au respect de leur intégrité physique, d’exprimer librement leurs convictions, de vivre décemment, de travailler, d’être éduqué et soigné. Cette visée universaliste étant née au XVIIIe siècle dans la mouvance des Lumières européennes, certains pays expriment depuis une vingtaine d’années de sérieuses réserves sur le caractère universel des droits humains. Il s’agit surtout de pays d’Asie et d’Afrique qui ont été victimes de la colonisation et qui assimilent l’universalité des droits de l’homme à une posture colonialiste : après avoir imposé sa domination politique et économique, l’Occident entend imposer ses valeurs au reste du monde. Ces États s’appuient sur la notion de diversité culturelle pour défendre l’idée d’un relativisme des droits humains. Ceux-ci varient en fonction de la tradition ou de la culture de chaque pays. On peut comprendre un tel raisonnement, mais il ne faut pas être dupe. Il arrange terriblement les dictatures et permet de faire perdurer des pratiques de domination des traditions sur l’individu : domination de la femme sous mille formes (excision, mise à mort en cas d’adultère, mise sous tutelle par le père ou le mari), travail précoce des enfants, interdiction de changer de religion, etc. Ceux qui récusent l’universalité des droits humains l’ont bien compris : c’est bien en effet l’émancipation de l’individu à l’égard du groupe que permet l’application de ces droits. Or quel individu n’aspire-t-il au respect de son intégrité physique et morale ? L’intérêt du collectif n’est pas toujours celui de l’individu et c’est ici que se joue un choix de civilisation fondamental.
Par contre, il est parfaitement légitime de reprocher aux gouvernements occidentaux de ne pas toujours mettre en pratique ce qu’ils prônent ! La légitimité des droits humains serait infiniment plus forte si les démocraties étaient exemplaires. Or, pour ne prendre qu’un seul exemple, la manière dont l’armée américaine a traité les prisonniers irakiens ou ceux de Guantanamo (torture, absence de jugements, viols, humiliations) a fait perdre tout crédit moral à l’Occident aux yeux de nombreuses populations à qui nous donnons des leçons sur les droits de l’homme. Il nous est reproché, et à juste titre, que c’est au nom de la défense de valeurs comme la démocratie que les États-Unis et leurs alliés ont envahi l’Irak, alors que seules comptaient les raisons économiques. On peut aussi critiquer nos sociétés occidentales actuelles qui pèchent par excès d’individualisme. Le sens du bien commun y a en grande partie disparu, ce qui pose des problèmes de cohésion sociale. Mais entre ce défaut et celui d’une société où l’individu est totalement soumis à l’autorité du groupe et de la tradition, qui choisirait vraiment le second ? Le respect des droits fondamentaux de la personne me semble un acquis incontournable et sa visée universelle légitime. Reste ensuite à trouver une application harmonieuse de ces droits dans des cultures encore profondément marqués au sceau de la tradition, notamment religieuse, ce qui n’est pas toujours facile. Pourtant, à y regarder de plus près, chaque culture possède de façon endogène un fondement aux droits humains, ne serait-ce qu’à travers la fameuse règle d’or, écrite par Confucius il y a 2500 ans et inscrite d’une manière ou d’une autre au cœur de toutes les civilisations de l’humanité : « Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu’on te fasse à toi-même. » [...]
Le Monde des religions, juillet-août 2008 —
Survenant quelques mois avant les J.O. de Pékin, les émeutes de mars dernier au Tibet ont remis brutalement la question tibétaine sur le devant de la scène internationale. Face à l’émotion de l’opinion publique, les gouvernements occidentaux ont unanimement demandé au gouvernement chinois de renouer le dialogue avec le dalaï-lama, dont on sait que, contre le désir de la plupart de ses compatriotes, il ne réclame plus l’indépendance de son pays, mais simplement une autonomie culturelle au sein de la Chine. De timides contacts ont été noués, mais tous les observateurs avisés savent qu’ils ont bien peu de chances d’aboutir. L’actuel président chinois, Hu Jintao, était gouverneur du Tibet il y a vingt ans et il a si violemment réprimé les émeutes des années 1987-1989, qu’il a été qualifié de « boucher de Lhassa ». Cela lui a valu une belle ascension au sein du parti, mais a aussi laissé en lui un ressentiment tenace contre le leader tibétain qui a reçu la même année le prix Nobel de la paix. La politique des dirigeants chinois qui consiste à diaboliser le dalaï-lama et à attendre sa mort en poursuivant une politique de colonisation brutale au Tibet est fort risquée. Car contrairement à ce qu’ils affirment, les émeutes de mars dernier, comme celles d’il y a vingt ans, ne sont pas le fait du gouvernement tibétain en exil, mais de jeunes Tibétains qui ne supportent plus l’oppression dont ils sont victimes : emprisonnement pour délit d’opinion, interdiction de parler le tibétain dans les administrations, multiples entraves à la pratique religieuse, favoritisme économique en faveur des colons chinois qui deviennent plus nombreux que les Tibétains, etc. Depuis l’invasion du Tibet par l’armée populaire de Chine en 1950, cette politique de violence et de discrimination n’a fait que renforcer le sentiment nationaliste chez les Tibétains qui étaient jadis assez frondeurs face à l’État et qui vivaient davantage leur sentiment d’appartenance au Tibet par le biais identitaire d’une langue, d’une culture et d’une religion commune que par un sentiment politique de type nationaliste. Près de soixante ans de colonisation brutale n’ont fait que renforcer le sentiment nationaliste et une écrasante majorité des Tibétains souhaite recouvrer l’indépendance de son pays. Seule une personnalité aussi légitime et charismatique que le dalaï-lama est en mesure de leur faire avaler la pilule d’un renoncement à cette revendication légitime et de parvenir avec les autorités de Pékin à un accord sur une forme d’autonomie culturelle tibétaine dans un espace national chinois où les deux peuples pourraient essayer de cohabiter harmonieusement. Le 22 mars dernier, trente intellectuels chinois dissidents vivant en Chine ont publié dans la presse étrangère une tribune courageuse soulignant que la diabolisation du dalaï-lama et le refus de toute concession majeure au Tibet conduisaient la Chine dans l’impasse dramatique d’une répression permanente. Celle-ci ne fait que renforcer le sentiment anti-chinois chez les trois grands peuples colonisés – Tibétains, Ouïghours et Mongols – appelés « minorités » par les autorités communistes, qui ne représentent que 3 % de la population mais occupent près de 50 % du territoire. Formons ici le vœu pieu que les Jeux Olympiques de Pékin ne seront pas les Jeux de la honte, mais ceux qui permettront aux autorités chinoises d’accélérer l’ouverture au monde et aux valeurs de respect des droits humains, à commencer par la liberté des individus et des peuples à disposer d’eux-mêmes. [...]
Le Monde des religions, mai-juin 2008 —
Ces derniers mois ont été fertiles en polémiques sur le thème ultrasensible en France de la République et de la religion. On le sait en effet, la nation française s’est construite dans une émancipation douloureuse du politique à l’égard du religieux. De la Révolution française à la loi de séparation de 1905, la violence des luttes entre catholiques et Républicains a laissé des traces profondes. Là où, dans d’autres pays, la religion a joué un rôle important dans la construction du politique moderne et où la séparation des pouvoirs n’a jamais été conflictuelle, la laïcité française a été une laïcité de combat.
Sur le fond, j’adhère à l’idée de Nicolas Sarkozy de passer d’une laïcité combattante à une laïcité apaisée. Mais n’est-ce pas déjà le cas ? Le président de la République a raison de rappeler l’importance de l’héritage chrétien et d’insister sur le rôle positif que peuvent jouer les religions, tant dans l’espace privé que dans l’espace public. Le problème, c’est que ses propos ont été trop loin, ce qui a suscité, à juste titre, des réactions virulentes. À Rome (20 décembre), il met en concurrence le curé et l’instituteur, figure emblématique de la République laïque, en affirmant que le premier est supérieur au second dans la transmission des valeurs. La déclaration de Ryad (14 janvier) est encore plus problématique. Certes Nicolas Sarkozy rappelle à juste titre que « ce n’est pas le sentiment religieux qui est dangereux, mais son utilisation à des fins politiques ». Il fait cependant une profession de foi fort surprenante : « Dieu transcendant qui est dans la pensée et dans le cœur de chaque homme. Dieu qui n’asservit pas l’homme mais le libère. » Le pape ne saurait mieux dire. Dans la bouche du président d’une nation laïque, ces propos ont de quoi surprendre. Non pas que l’homme, Nicolas Sarkozy, n’ait pas le droit de les penser. Mais tenus dans un contexte officiel, ils engagent la nation et ne peuvent que choquer, voire scandaliser, tous les Français qui ne partagent pas les opinions spirituelles de Monsieur Sarkozy. Dans l’exercice de sa fonction, le président de la République doit conserver une neutralité face aux religions : ni dénigrement, ni apologie. On me rétorquera que les présidents américains ne se privent pas de faire référence à Dieu dans leurs discours alors que la constitution américaine sépare aussi formellement que la nôtre les pouvoirs politiques et religieux. Certes, mais la foi en Dieu et dans le rôle messianique de la nation américaine fait partie des évidences partagées par le plus grand nombre, et fonde une sorte de religion civile. En France, la religion ne rassemble pas, elle clive.
On le sait, l’enfer est pavé de bonnes intentions. Avec la noble intention de réconcilier République et religion, Nicolas Sarkozy risque, par maladresse et par excès de zèle, de produire le résultat exactement inverse de celui recherché. Sa collaboratrice Emmanuelle Mignon a commis la même erreur avec le dossier tout aussi sensible des sectes. Entendant rompre avec une politique parfois trop aveugle de stigmatisation des groupes religieux minoritaires, politique condamnée par de nombreux juristes et universitaires – j’avais moi-même fortement critiqué à l’époque le rapport parlementaire de 1995 et la liste aberrante qui l’accompagnait -, elle va trop loin en affirmant que les sectes constituent « un non-problème ». Du coup, ceux qu’elle critique avec raison ont beau jeu de rappeler, avec tout autant de raison, qu’il y a des dérives sectaires graves qui ne peuvent en aucun cas être considérées comme un non-problème ! Pour une fois qu’on ose aborder au sommet de l’État la question religieuse de manière nouvelle et décomplexée, il est regrettable que des prises de position trop tranchées ou inappropriées rendent ce langage si peu audible et contre-productif. [...]
Le Monde des religions, mars-avril 2008 —
Cher Régis Debray,
Dans votre chronique, que j’invite le lecteur à lire avant d’aller plus loin, vous m’interpellez de manière fort stimulante. Même si vous caricaturez quelque peu ma thèse sur le christianisme, j’admets parfaitement une différence de point de vue entre nous. Vous soulignez son caractère collectif et politique quand j’insiste sur le caractère personnel et spirituel du message de son fondateur. Je comprends très bien que vous vous interrogiez sur le fondement du lien social. Dans vos écrits politiques, vous avez montré de manière convaincante que celui-ci repose toujours, d’une manière ou d’une autre, sur un « invisible », c’est-à-dire une forme quelconque de transcendance. Le Dieu des chrétiens a été cette transcendance en Europe jusqu’au XVIIIe siècle, la raison déifiée et le progrès lui ont succédé, puis le culte de la patrie et les grandes idéologies politiques du XXe siècle. Après l’échec, parfois tragique, de toutes ces religions séculières, je m’inquiète comme vous de la place que prend l’argent comme nouvelle forme de religion dans nos sociétés individualistes. Mais que faire ?
Faut-il avoir une nostalgie de la chrétienté, c’est-à-dire d’une société régentée par la religion chrétienne, comme il existe aujourd’hui des sociétés régentées par la religion musulmane ? Nostalgie d’une société sur l’autel de laquelle étaient sacrifiés la liberté individuelle et le droit à la différence de pensée et de religion ? Ce dont je suis convaincu, c’est que cette société qui portait le nom de « chrétienne » et qui a par ailleurs construit de grandes choses, n’était pas véritablement fidèle au message de Jésus qui prônait d’une part la séparation du politique et du religieux, et insistait d’autre part sur la liberté individuelle et sur la dignité de la personne humaine. Je ne dis pas que le Christ a voulu supprimer toute religion, avec ses rites et ses dogmes, comme ciment d’une société, mais j’ai voulu montrer que l’essentiel de son message tend à émanciper l’individu du groupe en insistant sur sa liberté personnelle, sa vérité intérieure et son absolue dignité. À telle enseigne que nos valeurs modernes les plus sacrées – celles des droits de l’Homme – plongent en grande partie leurs racines dans ce message.
Le Christ, comme avant lui le Bouddha, et à la différence d’autres fondateurs de religions, ne se préoccupe pas d’abord de politique. Il propose une révolution de la conscience individuelle susceptible de conduire, à long terme, à un changement de la conscience collective. C’est parce que les individus seront plus justes, plus conscients, plus vrais, plus aimants, que les sociétés finiront aussi par évoluer. Jésus n’appelle pas à une révolution politique, mais à une conversion personnelle. A une logique religieuse fondée sur l’obéissance à la tradition, il oppose une logique de responsabilité individuelle.
Je vous l’accorde, ce message est assez utopique et nous vivons actuellement dans un certain chaos où les logiques antérieures fondées sur l’obéissance aux lois sacrées du groupe ne fonctionnent plus et où peu d’individus sont encore engagés dans une véritable démarche d’amour et de responsabilité. Mais qui sait ce qu’il en sera dans quelques siècles ? J’ajouterais que cette révolution de la conscience individuelle ne s’oppose nullement à des croyances religieuses ou politiques partagées par le grand nombre, ni à une institutionnalisation du message, dont vous rappelez à juste titre le caractère inéluctable. Elle pourra cependant leur mettre une limite : celle du respect de la dignité de la personne humaine. C’est à mon sens tout l’enseignement du Christ, qui n’annule en rien la religion, mais la cadre dans trois principes intangibles: amour, liberté, laïcité. Et c’est une forme de sacralité, me semble-t-il, qui peut aujourd’hui réconcilier croyants et incroyants. [...]
Le Monde des religions, janvier-février 2008 —
L’histoire se passe en Arabie Saoudite. Une jeune femme mariée âgée de 19 ans retrouve un ami d’enfance. Ce dernier l’invite dans sa voiture pour lui remettre une photo. Sept hommes surviennent et les kidnappent. Ils violentent l’homme et violent la femme à plusieurs reprises. Cette dernière porte plainte. Les violeurs sont condamnés à de faibles peines de prison, mais la victime et son ami sont aussi condamnés par le tribunal à recevoir 90 coups de fouet pour s’être trouvés seuls et en privé avec une personne du sexe opposé n’appartenant pas à leur famille immédiate (cette infraction est appelée khilwa dans le droit islamique, la charia). La jeune femme décide de faire appel, prend un avocat et rend l’affaire publique. Le 14 novembre dernier, le tribunal porte sa peine à 200 coups de fouet et la condamne en plus à six ans de prison. Un fonctionnaire de la cour générale de Qatif, qui a prononcé le jugement le 14 novembre, a expliqué que la cour avait aggravé la peine de la femme en raison de « sa tentative d’envenimer la situation et d’influencer l’appareil judiciaire par l’entremise des médias ». Le tribunal a également harcelé son avocat, lui interdisant de s’occuper du dossier et lui confisquant sa licence professionnelle. Human Rights Watch et Amnesty International se sont emparés du dossier et tentent d’intervenir auprès du roi Abdallah pour qu’il fasse annuler la décision inique de ce tribunal. Peut-être y parviendront-ils ? Mais pour une femme qui a eu le courage de se révolter et de rendre publique son histoire dramatique, combien d’autres subissent des viols sans jamais oser porter plainte de peur d’être elles-mêmes accusées d’avoir séduit le violeur ou d’avoir eu des relations coupables avec un homme qui n’était pas leur mari ? La situation de la femme en Arabie Saoudite, comme en Afghanistan, comme au Pakistan, comme en Iran, comme dans d’autres pays musulmans qui appliquent de manière stricte la charia, est intolérable.
Dans le contexte international actuel, toute critique émanant d’ONG ou de gouvernements occidentaux est perçue comme une ingérence inacceptable, non seulement par les autorités politiques et religieuses, mais aussi par une partie de la population. La condition de la femme dans les pays musulmans n’a donc de chance de véritablement progresser que si les opinions publiques de ces pays réagissent aussi. L’affaire que je viens de raconter a été médiatisée et a suscité un certain émoi en Arabie Saoudite. C’est ainsi par le courage exceptionnel de certaines femmes victimes d’injustices, mais aussi d’hommes sensibles à leur cause, que les choses vont bouger. Dans un premier temps, ces réformateurs peuvent s’appuyer sur la tradition pour montrer qu’il existe d’autres lectures et d’autres interprétations du Coran et de la charia, qui donnent une meilleure place à la femme et la protègent davantage de l’arbitraire d’une loi machiste.
C’est ce qui s’est passé en 2004 au Maroc avec la réforme du code de la famille qui constitue un progrès considérable. Mais une fois ce premier pas assuré, les pays musulmans n’échapperont pas à une remise en cause plus profonde, à la véritable émancipation de la femme d’une conception et d’une loi religieuses élaborées il y a des siècles au sein de sociétés patriarcales qui n’admettaient aucune égalité entre les hommes et les femmes. La laïcité a permis en Occident cette révolution extrêmement récente des mentalités. Nul doute que l’émancipation définitive de la femme en terre d’islam passera aussi par une totale séparation du religieux et du politique. [...]
Le Monde des religions, septembre-octobre 2007 —
J’ai été un peu surpris de l’avalanche de critiques, y compris au sein de l’Église, qu’a suscité la décision du pape de rétablir la messe en latin. J’ai assez pointé depuis deux ans la politique ultraréactionnaire de Benoît XVI dans tous les domaines, pour ne pas résister ici au plaisir de voler à son secours ! Que le pape veuille ainsi ramener au bercail les brebis égarées de
Mgr Lefebvre, évidemment. Mais il n’y a là nul opportunisme de sa part car le cardinal Ratzinger n’a de cesse de rappeler pendant plus de trente ans son malaise devant l’application de la réforme liturgique de Vatican II et son souhait de redonner aux fidèles le choix entre le nouveau et l’ancien rite hérité du pape Pie V (qui l’avait promulgué en 1570). Voilà qui sera fait à partir du 14 septembre. Pourquoi se plaindre d’une mesure qui offre, fait rarissime, une authentique liberté de choix aux fidèles ? Une fois l’ancien rituel dépouillé de ses phrases hostiles aux juifs qui témoignaient du vieux fond d’antijudaïsme chrétien qui avait perduré jusqu’au concile Vatican II, je ne vois pas très bien en quoi la messe de Pie V, dite dos aux fidèles et en latin, constituerait un terrible retour en arrière pour l’Eglise.
Trois expériences personnelles me convainquent au contraire de la justesse de la décision du pape. J’ai été frappé en me rendant à Taizé de découvrir que ces milliers de jeunes venus du monde entier chantaient en latin ! Frère Roger m’en avait alors expliqué la raison : devant la diversité de langues parlées, le latin s’était imposé comme le langage liturgique pouvant être pratiquée par tous. Expérience similaire à Calcutta, dans une chapelle des missionnaires de la charité de mère Teresa, lors de la messe célébrée pour les nombreux bénévoles venus de tous pays : presque tous pouvaient participer à la liturgie, parce qu’elle était dite en latin et que, visiblement, les souvenirs d’enfance des participants étaient encore vivaces. Le latin, langue liturgique universelle de l’Eglise catholique à côté des messes en langues vernaculaires, pourquoi pas ? Dernière expérience, vécue lors de l’enquête sociologique que j’ai menée il y a une dizaine d’années auprès de dizaines d’adeptes français du bouddhisme tibétain : j’ai été très surpris d’entendre chez plusieurs d’entre eux qu’ils appréciaient les rites tibétains parce qu’ils étaient effectués dans une langue qui n’était pas leur langue natale ! Ils m’affirmaient trouver la messe dominicale en français pauvre et sans mystère, alors qu’ils ressentaient le sacré dans les pratiques tibétaines. Le tibétain faisait office de latin. Qui sait : Benoît XVI ne ramènera peut-être pas que des intégristes dans le giron de l’Église (1).
…
Fondé en septembre 2003, le Monde des Religions souffle sa quatrième bougie. À vous de juger de la qualité du journal. Mais le bilan comptable est extrêmement positif. La diffusion du magazine était en moyenne de 42 000 exemplaires en 2004. Elle a fait un bond à 57 000 exemplaires en 2005 et a continué sa forte progression avec une diffusion moyenne de 66 000 exemplaires en 2006. Selon le magazine Stratégies, le Monde des Religions a connu la troisième plus forte progression de la presse française en 2006. L’occasion de vous remercier, chers lecteurs, ainsi que tous ceux qui font le magazine, et de vous signaler la refonte des pages Forum qui gagnent en dynamisme. Je voudrais aussi remercier Jean-Marie Colombani, qui a quitté cet été ses fonctions de directeur du groupe La Vie-Le Monde. Sans lui, le Monde des Religions n’aurait jamais vu le jour. Lorsqu’il m’a recruté comme directeur de la rédaction, il m’a dit combien il lui semblait important que puisse exister une revue parlant du fait religieux dans une approche résolument laïque. Il n’a cessé de nous soutenir à l’époque où la revue était encore déficitaire et nous a toujours laissé une totale liberté dans nos choix éditoriaux.
(1) Voir le débat p. 17. [...]
Le monde des religions, novembre-décembre 2007 —
Mère Teresa a donc douté de l’existence de Dieu. Pendant des décennies, elle a eu l’impression que le ciel était vide. Cette révélation a choqué. Le fait paraît stupéfiant compte tenu des références constantes qu’elle faisait à Dieu. Pourtant, le doute n’est pas la négation de Dieu – c’est une interrogation – et la foi n’est pas une certitude. On confond certitude et conviction. La certitude vient d’une évidence sensible indiscutable (ce chat est noir) ou d’une connaissance rationnelle universelle (lois de la science). La foi est une conviction individuelle et subjective. Elle s’apparente chez certains croyants à une opinion molle ou un héritage non critiqué, chez d’autres à une intime conviction plus ou moins forte. Mais, dans tous les cas, elle ne peut être une certitude sensible ou rationnelle : nul n’aura jamais une preuve certaine de l’existence de Dieu. Croire n’est pas savoir. Croyants et non-croyants auront toujours d’excellents arguments pour expliquer que Dieu existe ou n’existe pas : aucun ne prouvera jamais quoi que ce soit. Comme l’a montré Kant, l’ordre de la raison et celui de la foi sont de nature différente. L’athéisme et la foi relèvent de la conviction, et de plus en plus de gens en Occident se disent d’ailleurs agnostiques : ils reconnaissent n’avoir aucune conviction définitive sur cette question.
Puisqu’elle ne repose ni sur une évidence sensible (Dieu est invisible) ni sur une connaissance objective, la foi implique nécessairement le doute. Et ce qui apparaît comme paradoxal, mais qui est tout à fait logique, c’est que ce doute est proportionné à l’intensité de la foi elle-même. Un croyant qui adhère faiblement à l’existence de Dieu sera plus rarement traversé de doutes ; ni sa foi, ni ses doutes ne bouleverseront sa vie. À l’inverse, un croyant qui a vécu des moments de foi intenses, lumineux, voire qui a misé toute sa vie sur la foi comme mère Teresa, finira par ressentir l’absence de Dieu comme terriblement douloureuse. Le doute deviendra une épreuve existentielle. C’est ce que vivent et décrivent les grands mystiques, comme Thérèse de Lisieux ou Jean de la Croix, lorsqu’ils parlent de « la nuit obscure » de l’âme, où toutes les lumières intérieures s’éteignent, laissant le croyant dans la foi la plus nue parce qu’elle n’a plus rien sur quoi s’appuyer. Jean de la Croix explique que c’est ainsi que Dieu, en donnant l’impression de se retirer, éprouve le cœur du fidèle pour le conduire plus loin sur le chemin de la perfection de l’amour. C’est une bonne explication théologique. D’un point de vue rationnel extérieur à la foi, on peut très bien expliquer cette crise par le simple fait que le croyant ne peut jamais avoir de certitudes, de connaissance objective, sur ce qui fonde l’objet de sa foi, et il en vient nécessairement à s’interroger. L’intensité de son doute sera à la mesure de l’importance existentielle de sa foi.
Il existe certes des croyants très engagés, très religieux, qui affirment ne jamais connaître de doutes : les intégristes. Mieux même, ils font du doute un phénomène diabolique. Pour eux, douter, c’est faillir, trahir, sombrer dans le chaos. Parce qu’ils érigent à tort la foi en certitude, ils s’interdisent intérieurement et socialement de douter. Le refoulement du doute conduit à toutes sortes de crispations : intolérance, pointillisme rituel, rigidité doctrinale, diabolisation des incroyants, fanatisme allant parfois jusqu’à la violence meurtrière. Les intégristes de toutes les religions se ressemblent parce qu’ils refusent le doute, cette face sombre de la foi, qui en est pourtant l’indispensable corollaire. Mère Teresa a reconnu ses doutes, aussi douloureux fussent-ils à vivre et à dire, parce que sa foi était animée par l’amour. Les intégristes n’accueilleront ou n’admettront jamais les leurs, parce que leur foi est fondée sur la peur. Et la peur interdit de douter.
P.S. : Je me réjouis de l’arrivée de Christian Bobin parmi nos chroniqueurs. [...]
Le Monde des religions, juillet-août 2007 —
Après l’inquiétude du 6 juin 2006 (666), voici l’euphorie du 7 juillet 2007 (777). Les marchands de jeux de hasards soulignent l’importance symbolique de ces dates, le cinéma hollywoodien s’est emparé du fameux chiffre de la bête de l’Apocalypse (666) et les maires reçoivent avec étonnement un nombre élevé de demandes de mariage pour ce fameux 7 juillet. Mais parmi les adeptes du chiffre 7, qui en connaît vraiment la symbolique ? Ce nombre s’est imposé dans la lointaine antiquité comme signe de plénitude et de perfection à cause des sept planètes alors observables. Il a gardé dans la Bible hébraïque ce sens d’accomplissement : le septième jour, Dieu se repose après les six jours de la création. Au Moyen Âge, les théologiens chrétiens reprennent cette signification et soulignent que le 7 manifeste l’alliance du ciel (le 3) et de la terre (le 4). On se met dès lors à traquer et à interpréter sa présence dans les Écritures : les sept dons de l’Esprit, les sept paroles du Christ en croix, les sept demandes du Pater, les sept Églises de l’Apocalypse, sans parler des sept anges, des sept trompettes et des sept sceaux. La scolastique médiévale s’ingénie aussi à tout ramener à ce nombre parfait : les sept vertus (les quatre cardinales venant de l’homme et les trois théologales venant de Dieu), les sept sacrements, les sept péchés capitaux, les sept cercles de l’enfer…
L’engouement récent d’un certain nombre de nos contemporains pour la symbolique des nombres (que l’on songe aussi au succès planétaire des « énigmes » du Da Vinci Code ou au succès outre-Atlantique d’une kabbale de pacotille), n’est toutefois plus fondé sur une culture religieuse qui lui donnait sens et cohérence. Il se résume évidemment le plus souvent à une approche superstitieuse. Pour autant, ne traduit-il pas un besoin réel de renouer avec une pensée symbolique, laquelle a été évacuée de nos sociétés modernes depuis le triomphe du scientisme ?
Parmi les nombreuses définitions de l’homme, on pourrait dire qu’il est le seul animal capable de symbolisation. Le seul à chercher dans le monde qui l’entoure un sens caché, profond, qui le relie à un monde intérieur ou invisible. L’étymologie grecque du mot « symbole », sumbolon, renvoie à un objet qu’on a séparé en plusieurs morceaux et dont la réunion des pièces offre un signe de reconnaissance. À l’inverse du diable (diabolon) qui divise, le symbole unit, associe.
Il répond à un besoin ancré dans la psyché de relier le visible et l’invisible, l’extérieur et l’intérieur. C’est pourquoi, dès l’aube de l’humanité, le symbole apparaît comme la manifestation par excellence de la profondeur de l’esprit humain et du sentiment religieux (religion, dont l’étymologie latine religare signifie aussi « relier »). Lorsque l’homme préhistorique pose ses morts sur un coussin de fleurs, il associe le symbole de la fleur à l’affection qui le relie à eux. Lorsqu’il place les cadavres en position fœtale, la tête tournée vers l’est, il associe la symbolique du fœtus et celle du soleil levant à la renaissance, et manifeste ainsi sa croyance, ou son espérance, en une vie après la mort.
À la suite des romantiques allemands, Carl Gustav Jung a montré que l’âme de l’homme moderne est malade du manque de mythes et de symboles. Certes la modernité a inventé de nouveaux mythes et de nouveaux symboles – ceux de la publicité par exemple – mais ils ne répondent pas aux aspirations de sens, c’est-à-dire profondes et universelles, de notre psyché. Depuis une trentaine d’années, le retour de l’astrologie et de l’ésotérisme, les succès planétaires d’œuvres de fiction comme le Seigneur des anneaux, l’Alchimiste, Harry Potter ou le Monde de Narnia, sont les signes d’un besoin de « réenchantement du monde ». L’être humain ne peut pas, en effet, se relier au monde et à la vie uniquement par sa raison logique. Il a besoin de s’y relier aussi par son cœur, sa sensibilité, son intuition et son imaginaire. Le symbole redevient dès lors une porte d’accès au monde et à lui-même. À condition toutefois qu’il fasse un effort minimum de connaissance et de discernement rationnel. Car s’abandonner à la seule pensée magique l’enfermerait au contraire dans un totalitarisme de l’imaginaire pouvant conduire à un délire interprétatif des signes. [...]
Le Monde des religions, mai-juin 2007 —
“Jésus camp ». C’est le nom d’un documentaire édifiant consacré aux évangéliques américains sorti le 18 avril sur les écrans français. On suit la « formation à la foi » d’enfants de 8 à 12 ans de familles appartenant au mouvement évangélique. Ils suivent les cours de catéchisme d’une missionnaire, fan de Bush, dont les propos font froid dans le dos. Les pauvres aimeraient bien lire Harry Potter, comme leurs petits camarades, mais la dame catéchiste le leur interdit formellement, rappelant sans rire que les sorciers sont les ennemis de Dieu et que « dans l’Ancien Testament, Harry Potter aurait été mis à mort ». La caméra saisit alors un petit instant de bonheur: un enfant de parents divorcés confie malicieusement à son voisin qu’il a pu voir le DVD du dernier opus… chez son père ! Mais la condamnation des crimes du sorcier de papier est peu de choses à côté du bourrage de crâne dont sont victimes ces enfants au sein du camp de vacances. Tout le programme des conservateurs américains y passe, et avec le plus mauvais goût : une visite d’un président Bush en carton pâte qu’on leur fait saluer comme le nouveau Messie ; une distribution de petits foetus en plastique pour qu’ils réalisent l’horreur de l’avortement ; une critique radicale des théories darwiniennes sur l’évolution des espèces… Le tout dans une atmosphère permanente de kermesse, d’applaudissements et de chants en langue. À la fin du documentaire, la dame catéchiste se voit reprocher par un journaliste d’opérer un véritable lavage du cerveau des enfants. La question ne la choque nullement : «Oui, répond-elle, mais les musulmans font exactement la même chose avec leurs enfants. » L’islam est une des obsessions de ces évangéliques pro-Bush. Une scène étonnante clôt le film : une petite fille missionnaire, qui doit avoir 10 ans, aborde dans la rue un groupe de personnes noires pour leur demander « où ils pensent aller après la mort ». La réponse la laisse pantoise. «Ils sont sûrs d’aller au paradis… alors qu’ils sont musulmans », confie-t-elle à son jeune copain de mission. «Ce doit être des chrétiens », conclut ce dernier après un instant de flottement. Ces gens-là n’ont d’« évangélique » que le nom. Leur idéologie sectaire (nous sommes les vrais élus) et guerrière (nous allons dominer le monde pour le convertir) est aux antipodes du message des Évangiles.
On finit aussi par être écoeuré par leur obsession du péché, notamment sexuel. On se dit que cette insistance à condamner le sexe (avant le mariage, hors mariage, entre personnes du même sexe) doit cacher bien des pulsions refoulées. Ce qui vient d’arriver au révérend Ted Haggard, le charismatique président de l’Association nationale évangélique américaine, qui regroupe 30 millions de membres, en est la parfaite illustration. On le voit dans le film haranguer les enfants. Mais ce que le film ne dit pas, car le scandale est arrivé après, c’est que ce héraut de la lutte contre l’homosexualité a été dénoncé, il y a quelques mois, par un prostitué de Denver, comme un client particulièrement assidu et pervers. Après avoir nié les faits, le pasteur a finalement reconnu son homosexualité, « cette saleté » dont il se dit victime depuis des années dans une longue lettre envoyée à ses fidèles pour expliquer sa démission. Cette Amérique mensongère et hypocrite, celle de Bush, fait peur. Il faut cependant éviter les amalgames malheureux. Véritables miroirs des talibans afghans, ces intégristes chrétiens enfermés dans leurs pauvres certitudes et dans leur effrayante intolérance ne représentent pas la totalité des quelque 50 millions d’évangéliques américains, dont il faut rappeler qu’ils étaient majoritairement hostiles à la guerre en Irak. Prenons garde aussi à ne pas identifier ces fous de Dieu avec les évangéliques français, enracinés en France depuis parfois plus d’un siècle et qui sont aujourd’hui plus de 350 000 à travers 1 850 lieux de culte. Leur ferveur émotionnelle et leur prosélytisme inspiré des mega churches américaines peuvent nous indisposer. Ce n’est pas une raison pour les assimiler à des sectes dangereuses, comme l’ont trop facilement fait les pouvoirs publics depuis une dizaine d’années. Mais ce documentaire nous montre que la certitude de « posséder la vérité » peut vite faire basculer dans le sectarisme haineux des gens sans doute parfaitement bien intentionnés. [...]
Le Monde des religions, mars-avril 2007 —Repris et commenté par plus de 200 médias, le sondage CSA sur les catholiques français que nous avons publié dans notre dernier numéro a eu un impact considérable et suscité de nombreuses réactions en France et à l’étranger. Même le Vatican, en la personne du cardinal Poupard, a réagi, dénonçant « l’analphabétisme religieux » des Français. Je voudrais revenir sur quelques-unes de ces réactions.
Des membres de l’Église ont souligné à juste titre que la chute spectaculaire du nombre de Français se déclarant catholiques (51 % contre 63 % dans les derniers sondages) était surtout due à la formulation de la question : « Quelle est votre religion, si vous en avez une ? » au lieu de la formule plus couramment utilisée : « À quelle religion appartenez- vous? » Cette dernière formulation renvoie davantage à un sentiment d’appartenance sociologique : je suis catholique parce que j’ai été baptisé. La formulation que nous avons adoptée a paru beaucoup plus pertinente pour mesurer une adhésion personnelle, laissant en outre plus ouverte la possibilité de s’affirmer « sans religion ». Il est bien évident, comme je n’ai cessé de le rappeler lors de la publication de ce sondage, qu’il y a plus de baptisés que de personnes se déclarant catholiques. Un sondage avec une formulation classique donnerait probablement d’autres chiffres. Mais qu’est-il plus intéressant de connaître? Le nombre de personnes ayant été élevées dans le catholicisme ou de celles qui se considèrent aujourd’hui comme catholiques ? La manière de poser la question n’est pas seule en cause dans les chiffres obtenus. Henri Tincq nous rappelle qu’en 1994, l’institut CSA avait posé, pour un sondage publié dans Le Monde, exactement la même question que pour le sondage publié en 2007 dans Le Monde des Religions : 67 % des Français se disaient alors catholiques, ce qui montre la forte érosion survenue en douze ans.
De nombreux catholiques – clercs ou laïcs – se sont par ailleurs sentis découragés par le déclin de la foi en France, exprimé par une série de chiffres: il ne reste ainsi, parmi les personnes se déclarant catholiques, qu’une minorité de fidèles véritablement engagés dans la foi. Je ne peux m’empêcher de mettre en perspective ce sondage avec la disparition récente de deux grands croyants, le dominicain Marie- Dominique Philippe et l’abbé Pierre (1), qui étaient de véritables amis.
Ces deux personnalités catholiques d’horizons si différents, me disaient en substance la même chose : cet effondrement, depuis plusieurs siècles, du catholicisme comme religion dominante, peut constituer une véritable chance pour le message évangélique : on pourrait le redécouvrir de manière plus vraie, plus personnelle, plus vécue. Mieux valait, aux yeux de l’abbé Pierre, peu de « croyants croyables » qu’une masse de croyants tièdes et contredisant par leurs actes la force du message chrétien. Le père Philippe pensait que l’Église, à la suite du Christ, devait passer par la passion du vendredi saint et l’enfouissement silencieux du samedi saint avant de connaître le bouleversement du dimanche de Pâques. Ces grands croyants n’étaient pas accablés par la baisse de la foi. Au contraire, ils y voyaient les germes possibles d’un grand renouveau, d’un événement spirituel majeur, mettant un terme à plus de dix-sept siècles d’une confusion entre foi et politique qui a dévoyé le message de Jésus : « Voici mon nouveau commandement : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Comme disait le théologien Urs von Balthazar : « Seul l’amour est digne de foi. » C’est ce qui expliquait la fabuleuse popularité de l’abbé Pierre et qui montre que les Français, à défaut de se sentir catholiques, restent extraordinairement sensibles au message fondamental des Évangiles. [...]
Le Monde des religions, janvier-février 2007 —“France, fille aînée de l’Église”. Prononcée en 1896, la formule du cardinal Langénieux renvoie à la réalité historique d’un pays où le christianisme s’est introduit au IIe siècle et qui, à partir du IXe siècle, a offert le modèle d’un peuple vivant à l’unisson autour de la foi, des symboles et du calendrier liturgique catholique. Ce que les historiens ont appelé « la chrétienté ».
Avec la Révolution française, puis la séparation de 1905 entre l’Église et l’État, la France est devenue un pays laïque, renvoyant la religion à la sphère privée. Pour de multiples raisons (exode rural, révolution des mœurs, montée de l’individualisme…), le catholicisme n’a cessé, depuis, de perdre son influence sur la société. Cette forte érosion est d’abord perceptible à travers les statistiques de l’Église de France, qui montrent une baisse constante des baptêmes, des mariages et du nombre de prêtres (voir pp. 43-44). Elle l’est ensuite à travers les enquêtes d’opinions qui mettent en avant trois marqueurs : la pratique (la messe), la croyance (en Dieu) et l’appartenance (se dire catholique).
Depuis quarante ans, le critère de religiosité le plus impliquant, la pratique régulière, est celui qui baisse le plus brutalement pour ne concerner que 10 % des Français en 2006. La croyance en Dieu qui reste à peu près stable jusqu’à la fin des années 1960 (autour de 75 %) tombe à 52 % en 2006. Le critère le moins impliquant, celui d’appartenance, qui renvoie tout autant à une dimension religieuse que culturelle, est demeuré très élevé jusqu’au début des années 1990 (autour de 80 %). Il connaît à son tour une baisse spectaculaire depuis quinze ans, passant à 69 % en 2000, 61 % en 2005, et notre sondage révèle qu’il est aujourd’hui de 51 %.
Surpris par ce résultat, nous avons demandé à l’institut CSA de refaire l’enquête auprès d’un échantillon national représentatif de 2 012 personnes âgées de 18 ans et plus. Même chiffre. Cette chute s’explique en partie par le fait que 5 % des sondés ont refusé de s’inscrire dans la liste des religions proposées par les instituts de sondages (catholique, protestante, orthodoxe, juive, musulmane, bouddhiste, sans religion…) et ont spontanément répondu « chrétien ». Contrairement à l’habitude de ramener de manière forcée ce pourcentage dans la catégorie « catholique », nous l’avons mentionné en catégorie séparée. Il nous semble en effet significatif que des personnes issues du catholicisme récusent cette appartenance tout en se disant chrétiennes. Quoi qu’il en soit, les Français sont de moins en moins nombreux à revendiquer leur appartenance au catholicisme, et de plus en plus nombreux à se dire « sans religion » (31 %). Les autres religions, très minoritaires, restent à peu près stables (4 % de musulmans, 3 % de protestants, 1 % de juifs).
Fort instructif aussi, le sondage mené sur les 51 % de Français qui se déclarent catholiques (voir pp. 23 à 28), montre à quel point les fidèles sont éloignés du dogme. Non seulement un catholique sur deux ne croit pas ou doute de l’existence de Dieu, mais parmi ceux qui affirment croire, seulement 18 % croient en un Dieu personnel (ce qui est pourtant un des fondements du christianisme), tandis que 79 % croient en une force ou une énergie. La distance avec l’institution est encore plus grande lorsqu’il s’agit de questions liées à la morale ou à la discipline : 81 % sont favorables au mariage des prêtres et 79 % à l’ordination des femmes. Et seulement 7 % considèrent que la religion catholique est la seule religion vraie. Le magistère de l’Église a donc perdu presque toute autorité sur les fidèles. Pourtant, ils sont 76 % à avoir une bonne opinion de l’Église et 71 % du pape Benoît XVI. Ce paradoxe, très intéressant, montre que les catholiques français qui sont en passe de devenir une minorité dans la population – et qui certainement se perçoivent déjà comme tels – épousent les valeurs dominantes de nos sociétés modernes profondément laïcisées, mais restent attachés, comme toute minorité, à leur lieu d’identification communautaire : l’Église et son principal symbole, le pape.
Disons-le clairement : non seulement dans ses institutions, mais aussi dans ses mentalités, la France n’est plus un pays catholique. C’est un pays laïque dont le catholicisme reste, et restera sans doute encore très longtemps, la religion la plus importante. Un chiffre : ce que nous percevons comme la « peau de chagrin » des catholiques pratiquants réguliers est numériquement équivalent à la totalité de la population juive, protestante et musulmane française (y compris les non croyants et les non pratiquants). [...]
Le Monde des religions, novembre-décembre 2006 —
Depuis l’affaire des caricatures de Mohamed, les signes de tensions se multiplient entre l’Occident et l’islam. Je devrais plutôt dire entre une partie du monde occidental et une partie du monde musulman. Mais cette série de crises pose la question : peut-on critiquer l’islam ? De nombreux leaders musulmans, et pas seulement des fanatiques extrémistes, souhaitent que la critique des religions soit interdite par le droit international au nom du respect des croyances. On peut comprendre cette attitude dans le contexte de sociétés où la religion englobe tout et où le sacré est la valeur suprême. Mais les sociétés occidentales se sont depuis longtemps sécularisées et ont clairement séparé la sphère du religieux de la sphère du politique. Dans un tel cadre, l’État garantit la liberté de conscience et d’expression de tous les citoyens. Libre donc à chacun de critiquer les partis politiques comme les religions. Cette règle permet à nos sociétés démocratiques de rester des sociétés de liberté. C’est pourquoi, même si je suis en désaccord avec les propos tenus par Robert Redeker contre l’islam, je me battrai pour qu’il ait le droit de les tenir et je dénonce avec la plus grande force le terrorisme intellectuel et les menaces de mort dont il est victime.
Contrairement à ce qu’affirmait Benoît XVI, ce n’est pas son rapport privilégié à la raison grecque, ni même le discours pacifique de son fondateur, qui ont permis au christianisme de renoncer à la violence. La violence qu’a exercée la religion chrétienne pendant des siècles – y compris durant l’âge d’or de la théologie rationnelle thomiste – n’a cessé que lorsque l’État laïc s’est imposé. Il n’y a donc pas d’autre issue pour un islam qui entend intégrer les valeurs modernes de pluralisme et de liberté individuelle que d’accepter cette laïcité et cette règle du jeu. Comme nous l’expliquions dans notre dernier dossier sur le Coran, cela implique une relecture critique des sources textuelles et de la loi traditionnelle, ce que font de nombreux intellectuels musulmans. Sur la laïcité et la liberté d’expression, il faut donc être sans ambiguïté. Ce serait aussi ruiner les souhaits et les efforts de tous les musulmans qui, à travers le monde, aspirent à vivre dans un espace de liberté et de laïcité que de céder au chantage des fondamentalistes.
Cela étant dit, et avec la plus grande fermeté, je suis aussi convaincu que nous devons avoir une attitude responsable et tenir des propos raisonnables sur l’islam. Dans le contexte actuel, les injures, les provocations et les approximations ne servent qu’à faire plaisir à leurs auteurs et rendent encore plus compliquée la tâche des musulmans modérés. Quand on se lance dans une critique « tripale », non argumentée ou dans une violente diatribe contre l’islam, on est sûr de susciter une réaction encore plus violente de la part des extrémistes. On pourra ensuite conclure : « Vous voyez, j’avais raison ». Sauf que pour 3 fanatiques qui répondent ainsi, on a 97 musulmans vivant sereinement leur foi ou simplement attachés à leur culture d’origine, qui sont doublement blessés par ces propos et par la réaction des extrémistes donnant une image désastreuse de leur religion.
Pour aider l’islam à se moderniser, un dialogue critique, rationnel et respectueux vaut cent fois mieux que l’invective et les propos caricaturaux. J’ajouterais que la pratique de l’amalgame est tout aussi dommageable. Les sources de l’islam sont diverses, le Coran lui-même est pluriel, les interprétations sont innombrables au long de l’histoire et les musulmans d’aujourd’hui sont tout aussi divers dans leur rapport à la religion. Évitons donc les amalgames réducteurs. Notre monde est devenu un village. Nous devons apprendre à vivre ensemble avec nos différences. Parlons, de part et d’autre, dans le souci de construire de ponts et non dans celui, très en vogue actuellement, d’édifier des murs. [...]
Le Monde des religions, septembre-octobre 2006 —
L’Evangile de Judas a été le best-seller international de l’été(1). Extraordinaire destin pour ce papyrus copte arraché aux sables après dix-sept siècles d’oubli et dont on ne connaissait jusqu’alors l’existence que par l’ouvrage de saint Irénée Contre les hérésies (180). Il s’agit donc d’une découverte archéologique importante(2). Elle n’apporte pourtant aucune révélation sur les derniers moments de la vie de Jésus et il n’y a guère de chance que ce petit livre puisse « agiter fortement l’Eglise », comme le proclame l’éditeur en quatrième de couverture.
D’abord parce que l’auteur de ce texte écrit au milieu du IIe siècle n’est pas Judas, mais un groupe gnostique qui a attribué la paternité du récit à l’apôtre du Christ pour lui donner plus de sens et d’autorité (procédé fréquent dans l’Antiquité). Ensuite parce que, depuis la découverte de Nag Hammadi (1945), qui a permis de mettre à jour une véritable bibliothèque gnostique comprenant de nombreux évangiles apocryphes, on connaît bien mieux la gnose chrétienne, et, finalement, L’Evangile de Judas n’apporte aucun éclairage nouveau sur la pensée de ce mouvement ésotérique.
Son succès foudroyant, parfaitement orchestré par le National Geographic qui a acheté les droits mondiaux, ne tient-il pas simplement à son titre extraordinaire : « L’Evangile de Judas ». Association de mots détonnante, impensable, subversive. L’idée que celui que les quatre Evangiles canoniques et la tradition chrétienne présentent depuis deux mille ans comme « le traître », « le méchant », « le suppôt de Satan » qui a vendu Jésus pour une poignée d’argent, ait pu écrire un évangile est intrigante. Qu’il ait voulu dire sa version des événements pour tenter de lever l’opprobre qui pèse sur lui est aussi formidablement romanesque, comme le fait que cet évangile perdu soit retrouvé après tant de siècles d’oubli.
Bref, pour peu qu’on ne connaisse rien du contenu de ce petit livre, on ne peut qu’être fasciné par un tel titre. Cela d’autant plus, comme l’a bien révélé le succès du Da Vinci Code, que notre époque doute du discours officiel des institutions religieuses sur les origines du christianisme et que la figure de Judas, comme celles de la longue liste des victimes ou des adversaires vaincus de l’Eglise catholique, est réhabilitée par l’art et la littérature contemporaine. Judas est un héros moderne, un homme émouvant et sincère, un ami déçu qui, au fond, a été l’instrument de la volonté divine. Car comment le Christ aurait-il pu accomplir son œuvre de salut universel s’il n’avait été livré par ce malheureux ? L’évangile attribué à Judas tente d’ailleurs de résoudre ce paradoxe en faisant dire explicitement à Jésus que Judas est le plus grand des apôtres, car il est celui qui va permettre sa mort : « Mais toi tu les surpasseras tous ! Car tu sacrifieras l’homme qui me sert d’enveloppe charnelle » (56). Cette parole résume bien la pensée gnostique : le monde, la matière, le corps sont l’œuvre d’un dieu mauvais (celui des Juifs et de l’Ancien Testament) ; le but de la vie spirituelle consiste, par l’initiation secrète, à ce que les rares élus qui possèdent une âme divine immortelle, issue du Dieu bon et inconnaissable, puissent la libérer de la prison de leur corps. Il est assez amusant de constater que nos contemporains, épris de tolérance, plutôt matérialistes et qui reprochent au christianisme son mépris de la chair, s’entichent d’un texte issu d’un courant qui fut condamné en son temps par les autorités de l’Eglise pour son sectarisme et parce qu’il considérait que l’univers matériel et le corps physique étaient une abomination.
1. L’Evangile de Judas, traduction et commentaires de R. Kasser, M. Meyer et G. Wurst, Flammarion, 2006, 221 p., 15 €.
2. Voir Le Monde des Religions, n° 18. [...]
Le Monde des religions, juillet-août 2006 —
L’une des principales causes de l’attrait du bouddhisme en Occident tient à la personnalité charismatique du Dalaï-lama et à son discours qui porte sur des valeurs fondamentales comme la tolérance, la non-violence, la compassion. Un discours qui fascine par son absence de prosélytisme auquel nous ont peu habitués les monothéismes : « Ne vous convertissez pas, restez dans votre religion », dit le maître tibétain. Est-ce un discours de façade, destiné au fond à séduire les Occidentaux ? La question m’a été souvent posée. J’y réponds en racontant une expérience que j’ai vécue et qui m’a profondément ému.
C’était il y a quelques années en Inde, à Dharamsala. Le Dalaï-lama m’avait donné rendez-vous pour les besoins d’un livre. Un rendez-vous d’une heure. La veille, à l’hôtel, je rencontre un bouddhiste anglais, Peter, et son fils Jack, 11 ans. L’épouse de Peter était décédée quelques mois plus tôt, après une longue maladie et de grandes souffrances. Jack avait exprimé le désir de rencontrer le Dalaï-lama. Peter avait donc écrit à ce dernier et obtenu un entretien de cinq minutes, le temps d’une bénédiction. Le père et le fils étaient ravis.
Le lendemain, je rencontre le Dalaï-lama ; Peter et Jack sont reçus juste après moi. Je m’attends à ce qu’ils regagnent très vite l’hôtel : ils n’arrivent qu’en fin de journée, totalement bouleversés. Leur rendez-vous a duré deux heures. Voici ce que m’en a dit Peter : « J’ai d’abord raconté au Dalaï-lama la mort de mon épouse, et j’ai fondu en larmes. Il m’a pris dans ses bras, m’a accompagné longuement dans ces pleurs, a accompagné mon fils, lui a parlé. Puis il m’a demandé ma religion : je lui ai dit mes origines juives et la déportation de ma famille à Auschwitz, que j’avais refoulée. Une blessure profonde s’est réveillée en moi, l’émotion m’a submergé, j’ai pleuré à nouveau. Le Dalaï-lama m’a repris dans ses bras. J’ai senti ses larmes de compassion : il pleurait avec moi, autant que moi. Je suis resté longtemps entre ses bras. Je lui ai ensuite parlé de mon itinéraire spirituel : mon manque d’intérêt pour la religion juive, ma découverte de Jésus à travers la lecture des Evangiles, ma conversion au christianisme qui fut, il y a vingt ans, la grande lumière de ma vie. Puis ma déception en ne retrouvant pas la force du message de Jésus dans l’Eglise anglicane, mon éloignement progressif, mon besoin profond d’une spiritualité qui m’aide à vivre et ma découverte du bouddhisme que je pratique, depuis plusieurs années, dans sa version tibétaine. Quand j’ai fini, le Dalaï-lama est resté silencieux. Puis il s’est retourné vers son secrétaire, lui a parlé en tibétain. Ce dernier est sorti, il est revenu avec une icône de Jésus. J’étais stupéfait. Le Dalaï-lama me l’a donnée en disant : “Bouddha est ma voie, Jésus est ta voie.” J’ai fondu en larmes pour la troisième fois. J’ai brusquement retrouvé tout l’amour que j’avais pour Jésus lors de ma conversion vingt ans plus tôt. J’ai compris que j’étais resté chrétien. Je recherchais dans le bouddhisme un support de méditation mais, au fond, rien ne me bouleversait plus que la personne de Jésus. En moins de deux heures, le Dalaï-lama m’a réconcilié avec moi-même et a guéri des blessures profondes. En partant il a promis à Jack qu’il le verrait chaque fois qu’il viendrait en Angleterre. »
Je n’oublierai jamais cette rencontre et le visage transformé de ce père et de son fils qui m’ont révélé à quel point la compassion du Dalaï-lama n’est pas un vain mot et qu’elle n’a rien à envier à celle des saints chrétiens.
Le Monde des religions, juillet-août 2006. [...]
Le Monde des religions, mai-juin 2006 —
Après le roman, le film. La sortie française, le 17 mai, du Da Vinci Code sur les écrans ne va pas manquer de relancer les spéculations sur les raisons du succès planétaire du roman de Dan Brown. La question est intéressante, peut-être davantage encore que le roman lui-même. Car les amateurs de thriller historique – et j’en suis – sont assez unanimes : le Da Vinci Code n’est pas un excellent cru.Construit comme un page turner, on est certes bien accroché dès les premières pages et les deux premiers tiers du livre se laissent dévorer avec plaisir, malgré le style hâtif et le manque de crédibilité et de profondeur psychologique des personnages. Puis l’intrigue s’essouffle, avant de s’effondrer dans une fin « abracadabrantesque ». Les plus de 40 millions d’exemplaires vendus et l’incroyable passion que suscite ce livre chez nombre de ses lecteurs relèvent donc davantage d’une explication sociologique que d’une analyse littéraire.
J’ai toujours pensé que la clé de cet engouement résidait dans la courte préface de l’écrivain américain, qui précise que son roman repose sur certains faits réels, dont l’existence de l’Opus Dei (ce qui est connu de chacun) et du fameux Prieuré de Sion, cette société secrète qui aurait été fondée à Jérusalem en 1099 et dont Léonard de Vinci aurait été le grand maître. Mieux encore : des « parchemins » déposés à la Bibliothèque nationale prouveraient l’existence de ce fameux prieuré. Toute l’intrigue du roman repose sur cette confrérie occulte qui aurait conservé un secret explosif que l’Eglise tente de dissimuler depuis les origines : les noces de Jésus et de Marie Madeleine et la place centrale de la femme dans l’Eglise primitive.
Cette thèse n’a rien de nouveau. Mais Dan Brown a su la faire sortir des cercles féministes et ésotériques pour la proposer au grand public sous la forme d’un polar à énigmes qui prétend s’appuyer sur des faits historiques ignorées de tous ou presque. Le procédé est habile, mais mensonger. Le Prieuré de Sion a été fondé en 1956 par Pierre Plantard, un mythomane antisémite qui se prenait pour le descendant des rois mérovingiens. Quant aux fameux « parchemins » déposés à la Bibliothèque nationale, ce sont en fait de vulgaires feuillets dactylographiés rédigés à la fin des années 1960 par ce même personnage et ses acolytes. Reste que pour des millions de lecteurs, et peut-être bientôt de spectateurs, Da Vinci Code constitue une véritable révélation : celle de la place centrale de la femme dans le christianisme primitif et du complot mis en place par l’Eglise au ive siècle pour redonner le pouvoir aux hommes. La théorie du complot, aussi détestable soit-elle – que l’on songe aux fameux Protocoles des Sages de Sion – fonctionne hélas toujours bien dans l’esprit d’un public de plus en plus méfiant à l’égard des institutions officielles, autant religieuses qu’universitaires.
Mais aussi erronée soit-elle dans sa démonstration historique et critiquable sous son emballage complotiste, la thèse du machisme de l’Eglise séduit d’autant plus qu’elle repose aussi sur un constat indéniable : seuls les hommes ont le pouvoir dans l’institution catholique et, depuis Paul et Augustin, la sexualité est dévalorisée. On comprend dès lors que de nombreux chrétiens, le plus souvent religieusement désocialisés, se soient laissés séduire par la thèse iconoclaste de Dan Brown et se lancent dans cette nouvelle quête du Graal des temps modernes : la redécouverte de Marie Madeleine et de la juste place de la sexualité et du féminin dans la religion chrétienne. Une fois les boniments browniens écartés, après tout, n’est-ce pas une belle quête ?
Le Monde des religions, mai-juin 2006. [...]
Le Monde des religions, mars-avril 2006 —
Peut-on rire des religions ? Au Monde des Religions, où nous sommes constamment confrontés à cette question, nous répondons oui, cent fois oui. Les croyances et les comportements religieux ne sont pas au-dessus de l’humour, ils ne sont pas au-dessus du rire et de la caricature critique, et nous avons donc choisi dès le départ, sans hésitation, d’introduire dans ce magazine des dessins humoristiques. Des garde-fous existent pour contenir les dérapages les plus graves : les lois condamnant le racisme et l’antisémitisme, l’incitation à la haine, la diffamation des individus. Est-il pour autant opportun de publier tout ce qui ne tomberait pas sous le coup de la loi ? Je ne le pense pas.
Nous nous sommes toujours refusés à publier un dessin bête et méchant, qui ne délivre aucun message donnant à réfléchir, mais qui vise seulement à blesser ou à détourner de manière gratuite une croyance religieuse, ou bien encore qui confonde tous les croyants d’une religion, par exemple à travers la figure de son fondateur ou de son symbole emblématique. Nous avons publié des dessins dénonçant les prêtres pédophiles, mais non des dessins montrant Jésus en prédateur pédophile. Le message aurait été : tous les chrétiens sont des pédophiles en puissance. De même, nous avons caricaturé des imams et des rabbins fanatiques, mais jamais nous ne publierons un dessin montrant Mohammed en poseur de bombe ou Moïse en assassin d’enfant palestinien. Nous refusons de laisser entendre que tous les musulmans sont des terroristes ou tous les juifs des tueurs d’innocents.
J’ajouterais qu’un directeur de journal ne peut faire abstraction des enjeux contemporains. Sa responsabilité morale et politique va au-delà du cadre juridique démocratique. Etre responsable, ce n’est pas simplement respecter les lois. C’est aussi faire preuve de compréhension et de conscience politique. Publier des dessins islamophobes dans le contexte actuel, c’est attiser inutilement les tensions et apporter de l’eau au moulin des extrémistes de tous bords. Certes, les représailles violentes sont inacceptables. Elles donnent d’ailleurs une image bien plus caricaturale de l’islam que tous les dessins incriminés et nombreux sont les musulmans qui s’en désolent. Certes, nous ne pouvons guère plus accepter de nous plier aux règles d’une culture qui interdirait toute critique de la religion. Certes, encore, nous ne pouvons oublier, ni tolérer, la violence des dessins antisémites publiés quasiment quotidiennement dans la plupart des pays arabes. Mais toutes ces raisons ne doivent pas nous servir d’alibi pour adopter une attitude provocatrice, agressive ou méprisante : ce serait faire fi des valeurs humanistes, d’inspiration religieuse ou laïque, qui fondent la civilisation dont nous nous réclamons avec fierté. Et si le vrai clivage n’était pas, contrairement à ce que l’on veut nous faire croire, entre l’Occident et le monde musulman, mais plutôt entre ceux qui, dans chacun de ces deux mondes, souhaitent l’affrontement et attisent le feu, ou, au contraire, ceux qui, sans nier ou minimiser les divergences culturelles, tentent d’instaurer un dialogue critique et respectueux, c’est-à-dire constructif et responsable.
Le Monde des religions, mars-avril 2006. [...]
Le Monde des religions, janvier-février 2006 —
II y a tout juste un an, en janvier 2005, paraissait la nouvelle formule du Monde des Religions. C’est pour moi l’occasion de vous parler de l’évolution rédactionnelle et commerciale du journal. Cette nouvelle formule a porté ses fruits, puisque notre titre progresse très fortement. La diffusion moyenne du magazine pour l’année 2004 (ancienne formule) était de 38 000 exemplaires par numéro. En 2005, elle est de 55 000 exemplaires, soit une progression de 45 %. Vous étiez 25 000 abonnés à la fin de l’année 2004, vous êtes aujourd’hui 30000. Mais c’est surtout la vente en kiosque qui a fait un bond spectaculaire, passant d’une moyenne de 13 000 exemplaires au numéro en 2004, à 25 000 exemplaires en 2005. Dans le climat plus que morose de la presse française – la plupart des titres sont en repli – une telle progression fait figure d’exception. Je remercie donc très chaleureusement tous nos abonnés et nos lecteurs fidèles qui ont assuré le succès du Monde des Religions. Pour autant, nous ne devons pas crier victoire trop vite, car nous sommes encore au seuil du cap de viabilité qui se situe au-dessus de 60 000 exemplaires. Nous comptons donc encore sur votre fidélité et sur votre désir de faire connaître Le Monde des Religions autour de vous pour assurer la pérennité du titre.Vous avez d’ailleurs été nombreux à écrire pour nous encourager ou nous faire part de vos critiques et je vous en remercie très vivement. J’ai tenu compte de certaines de vos remarques pour faire encore évoluer votre magazine. Vous constaterez dans ce numéro que la rubrique « Actualité » a été supprimée. En fait, notre rythme bimestriel et les dates très avancées du bouclage du numéro (environ un mois avant la parution) ne nous permettent pas de suivre le rythme de l’actualité. Nous avons donc été jusqu’au bout de la logique initiée lors de la nouvelle formule, en remplaçant les pages « Actualité » par un grand article de six pages, qui viendra en ouverture du journal, juste après l’éditorial, et qui sera soit un récit historique, soit une enquête sociologique. Ceci pour répondre à la demande de nombreux lecteurs de lire davantage d’articles longs et approfondis. Ce grand article sera suivi d’une rubrique « Forum », espace d’interactivité du journal, qui laissera encore plus de place au courrier des lecteurs, aux questions à Odon Vallet, aux réactions et chroniques de personnalités, ainsi qu’aux dessins humoristiques de divers auteurs (Chabert et Valdor ayant besoin de souffler un peu). Du coup, le grand entretien passe à la fin du magazine.Je profite aussi de ce premier anniversaire pour remercier tous ceux qui se sont battus pour que Le Monde des Religions puisse se développer, à commencer par Jean-Marie Colombani, sans qui ce titre n’existerait pas et qui nous a toujours apporté son appui et sa confiance. Merci aussi aux équipes de Malesherbes Publications et à ses dirigeants successifs, qui nous ont aidés et soutenus dans notre progression, ainsi qu’aux équipes commerciales du Monde qui se sont investies avec succès dans la promotion et la vente en kiosque. Enfin merci à la petite équipe du Monde des Religions ainsi qu’aux chroniqueurs et aux journalistes pigistes qui y sont associés, qui travaillent avec enthousiasme à vous offrir une meilleure connaissance des religions et des sagesses de l’humanité. [...]
Le Monde des religions, novembre-décembre 2005 —
Même si je répugne à parler dans ces colonnes d’un ouvrage dont je suis coauteur, il m’est impossible de ne pas dire un mot du dernier livre de l’abbé Pierre, qui touche à des sujets d’une brûlante actualité et qui risque de soulever bien des passions. *Pendant près d’un an, j’ai recueilli les réflexions et les interrogations du fondateur d’Emmaüs sur des thèmes très divers – du fanatisme religieux au problème du mal, en passant par l’Eucharistie ou le péché originel.
Sur vingt-huit chapitres, cinq sont consacrés à des questions de morale sexuelle. Compte tenu de la rigueur de Jean Paul II et de Benoît XVI sur ce sujet, les propos de l’abbé Pierre paraissent révolutionnaires. Pourtant, si on lit attentivement ce qu’il affirme, le fondateur d’Emmaüs reste assez mesuré. Il se dit favorable à l’ordination d’hommes mariés, mais affirme avec force la nécessité de maintenir le célibat consacré. Il ne condamne pas l’union de personnes du même sexe, mais souhaite que le mariage reste une institution sociale réservée aux hétérosexuels. Il pense que Jésus, puisqu’il est pleinement homme, a nécessairement ressenti la force du désir sexuel, mais il affirme aussi que rien dans l’Évangile ne permet d’affirmer s’il y a cédé ou non. Enfin, dans un domaine quelque peu différent, mais tout aussi sensible, il rappelle qu’aucun argument théologique déterminant ne semble s’opposer à l’ordination de femmes et que cette question relève avant tout de l’évolution des mentalités, qui ont été marquées jusqu’à nos jours par un certain mépris du « sexe faible ».
Si les propos de l’abbé Pierre ne manqueront pas de susciter des remous au sein de l’Église catholique, ce n’est pas donc parce qu’ils tendraient à absoudre le relativisme moral de notre époque (ce qui serait un bien mauvais procès), c’est parce qu’ils ouvrent une discussion sur la question, devenue véritablement taboue, de la sexualité. Et c’est parce que ce débat a été gelé par Rome, que les remarques et les questions posées par l’abbé Pierre sont capitales pour certains, dérangeantes pour d’autres. J’ai assisté à ce débat au sein même d’Emmaüs avant la publication du livre, lorsque l’abbé Pierre a donné à lire le manuscrit à son entourage. Les uns étaient enthousiastes, les autres mal à l’aise et critiques. Je rends d’ailleurs ici hommage aux divers responsables d’Emmaüs qui, quelle que soit leur opinion, ont respecté le choix de leur fondateur de publier ce livre en l’état. À l’un d’eux qui s’inquiétait de la place non négligeable consacrée dans l’ouvrage aux questions de sexualité – et plus encore de la manière dont les médias en rendraient compte – l’abbé Pierre faisait remarquer que ces questions de morale sexuelle tenaient finalement une très faible place dans les Évangiles. Mais c’était parce que l’Église attachait beaucoup d’importance à ces questions qu’il se sentait obligé d’en parler, de nombreux chrétiens et non chrétiens étant choqués par les positions intransigeantes du Vatican, sur des problèmes qui ne relèvent pas des fondements de la foi et qui méritent un vrai débat.
J’adhère totalement au point de vue du fondateur d’Emmaüs. J’ajouterais : si les Évangiles – auxquels nous consacrons notre dossier – n’insistent pas sur ces questions, c’est qu’ils n’ont pas d’abord vocation à constituer une morale individuelle ou collective, mais à ouvrir le cœur de chacun vers un abîme susceptible de bouleverser et de réorienter sa vie. À trop se focaliser sur le dogme et la norme au détriment de la seule annonce du message de Jésus qui disait « Soyez miséricordieux » et « Ne jugez pas », l’Église n’est-elle pas devenue, pour nombre de nos contemporains, un véritable obstacle vers la découverte de la personne et du message du Christ ? Nul n’est sans doute aujourd’hui mieux placé que l’abbé Pierre qui est, depuis soixante-dix ans, l’un des meilleurs témoins du message évangélique, pour s’en inquiéter.
*L’abbé Pierre, avec Frédéric Lenoir, ” Mon Dieu… Pourquoi ? ” Petites méditations sur la foi chrétienne et le sens de la vie, Plon, 27 octobre 2005. [...]
Le Monde des religions, septembre-octobre 2005 —
“Pourquoi le XXIe siècle est religieux.” Le titre du grand dossier de ce numéro de rentrée fait écho à la fameuse phrase attribuée à André Malraux : « Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas. » La formule fait mouche. Ressassée par tous les medias depuis une vingtaine d’années, elle est parfois retranscrite en un « le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas ». J’ai déjà assisté à des pugilats oratoires entre partisans des deux citations. Vain combat… puisque Malraux n’a jamais prononcé cette sentence ! Aucune trace de la formule ni dans ses livres, ni dans ses notes manuscrites, ni dans ses discours ou dans ses interviews. Mieux encore, l’intéressé lui-même n’a cessé de démentir cette citation lorsqu’on commença a lui en attribuer la paternité au milieu des années cinquante. Notre ami et collaborateur Michel Cazenave, parmi d’autres témoins proches de Malraux, nous le rappelait encore récemment. Alors, qu’a dit au juste le grand écrivain pour qu’on ait eu l’idée de mettre dans sa bouche une telle prophétie ? Tout semble s’être joué en 1955 autour de deux textes.
Répondant à une question envoyée par le journal danois Dagliga Nyhiter portant sur le fondement religieux de la morale, Malraux conclue ainsi sa réponse : « Depuis cinquante ans la psychologie réintègre les démons dans l’homme. Tel est le bilan sérieux de la psychanalyse. Je pense que la tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu’ait connu l’humanité, va être d’y réintroduire les dieux. » En mars de la même année, la revue Preuves publie deux rééditions d’entretiens parus en 1945 et 1946 qu’elle complète par un questionnaire envoyé à l’auteur de la Condition humaine. A la fin de cet entretien, Malraux déclare : « Le problème capital de la fin du siècle sera le problème religieux – sous une forme aussi différente de celle que nous connaissons, que le christianisme le fut des religions antiques. »
C’est à partir de ces deux citations que s’est construite – sans qu’on sache par qui – la fameuse formule. Or celle-ci prête fortement à équivoque. Car le « retour du religieux » auquel nous assistons, notamment sous sa forme identitaire et fondamentaliste, est aux antipodes du religieux auquel l’ancien ministre de la Culture du général de Gaulle fait allusion. La deuxième citation est, à cet égard, on ne peut plus explicite : Malraux annonce l’avènement d’une problématique religieuse radicalement différente de celles du passé. Dans de nombreux autres textes et entretiens il en appelle, à la manière du « supplément d’âme » de Bergson, à un événement spirituel majeur pour sortir l’homme de l’abîme dans lequel il s’est plongé au cours du XXe siècle (voir sur ce sujet le beau petit livre de Claude Tannery, l’Héritage spirituel de Malraux – Arléa, 2005). Cet événement spirituel n’a rien pour l’esprit agnostique de Malraux d’un appel à un renouveau des religions traditionnelles. Malraux croyait les religions aussi mortelles que l’étaient les civilisations pour Valéry. Mais elles répondaient pour lui à une fonction positive fondamentale, qui continuera à fonctionner : celle de créer des dieux qui sont « les torches une à une allumées par l’homme pour éclairer la voie qui l’arrache à la bête ». Lorsque Malraux affirme que « la tâche du XXIe siècle sera de réintroduire les dieux dans l’homme », il en appelle ainsi à un nouveau sursaut de religiosité, mais qui viendra du plus profond de l’esprit humain et qui ira dans le sens d’une intégration consciente du divin dans la psyché – à l’image des démons de la psychanalyse – et non d’une projection du divin vers une extériorité, comme cela était souvent le cas des religions traditionnelles. Autrement dit, Malraux attendait l’avènement d’une nouvelle spiritualité aux couleurs de l’homme, spiritualité qui est peut-être en germe, mais qui est encore bien étouffée en ce début de siècle par la fureur du choc des identités religieuses traditionnelles.
PS 1 : Je salue avec bonheur la nomination de Djénane Kareh Tager comme rédactrice en chef du Monde des Religions (elle occupait jusqu’à présent la fonction de secrétaire générale de la rédaction).
PS 2 : Je signale à nos lecteurs la création d’une nouvelle collection de hors série du Monde des Religions très pédagogique : « 20 clefs pour comprendre ». Le premier porte sur les religions de l’Egypte ancienne (voir page 7)
[...]
Le Monde des religions, juillet-août 2005.
Harry Potter, Da Vinci code, le Seigneur des Anneaux, l’Alchimiste : les plus grands succès littéraires et cinématographiques de la dernière décennie ont un point commun : ils répondent à notre besoin de merveilleux. Parsemés d’énigmes sacrées, de formules magiques, de phénomènes étranges, de terribles secrets, ils comblent notre goût du mystère, notre fascination pour l’inexpliqué. Car c’est bien là le paradoxe de notre ultramodernité : plus la science progresse et plus nous avons besoin de rêve et de mythe. Plus le monde semble déchiffrable et rationalisable, plus nous cherchons à lui redonner son aura magique. Nous assistons actuellement à une tentative de réenchantement du monde… justement parce que le monde a été désenchanté. Carl Gustav Jung en avait donné l’explication il y a un demi-siècle : l’être humain a autant besoin de raison que d’émotion, de science que de mythe, d’arguments que de symboles. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il n’est pas qu’un être de raison. Il se relie aussi au monde par son désir, sa sensibilité, son cœur, son imaginaire. Il se nourrit de rêves autant que d’explications logiques, de poésie et de légendes autant que de connaissances objectives. L’erreur du scientisme européen hérité du XIXe siècle (plus que des Lumières) a été de le nier. On a cru pouvoir éradiquer la part irrationnelle de l’homme et tout pouvoir expliquer selon la logique cartésienne. On a méprisé l’imagination et l’intuition. On a relégué le mythe au rang de fable pour enfant. Les Eglises chrétiennes ont en partie emboîté le pas à la critique rationaliste. Elles ont privilégié un discours dogmatique et normatif – faisant appel à la raison – au détriment de la transmission d’une expérience intérieure – liée au cœur – ou d’une connaissance symbolique qui parle à l’imaginaire.
On assiste donc aujourd’hui à un retour du refoulé. Les lecteurs de Dan Brown sont essentiellement des chrétiens qui vont chercher dans ses polars ésotériques la part de mystère, de mythe et de symboles qu’ils ne trouvent plus dans leurs Eglises. Les fans du Seigneur des Anneaux, comme les lecteurs assidus de Bernard Werber, sont bien souvent de jeunes adultes qui ont une bonne formation scientifique et technique, mais qui sont aussi en quête d’univers féeriques s’inspirant d’autres mythologies que celles de nos religions avec lesquels ils ont pris de sérieuses distances.
Faut-il s’inquiéter de ce retour du mythe et du merveilleux ? Assurément non, tant qu’il ne constitue pas, à son tour, un refus de la raison et de la science. Les religions, par exemple, devraient attacher plus d’importance à ce besoin d’émotion, de mystère, de symbole, sans renoncer pour autant à la profondeur d’un enseignement moral et théologique. Les lecteurs du Da Vinci code peuvent se laisser émouvoir par la magie romanesque et par celle des grands mythes de l’ésotérisme (le secret des Templiers,…), sans prendre pour argent comptant les thèses de l’auteur et réfuter la connaissance historique au nom d’une théorie du complot totalement fictive. Autrement dit, tout est une question de juste équilibre entre désir et réalité, émotion et raison. L’homme a besoin de merveilleux pour être pleinement humain, mais ne doit pas prendre ses rêves pour la réalité.
Le Monde des religions, juillet-août 2005. [...]
Le Monde des religions, mai-juin 2005 —
Penseur, mystique et pape au charisme exceptionnel, Karol Wojtyla laisse pourtant à son successeur un héritage contrasté. Jean Paul II a abattu bien des murs, mais en a érigé d’autres. Ce long pontificat paradoxal d’ouverture, notamment à l’adresse des autres religions, et de fermeture doctrinale et disciplinaire, signera, quoi qu’il en soit, une des pages les plus importantes de l’histoire de l’Eglise catholique et sans doute de l’Histoire. Au moment où j’écris ces lignes, les cardinaux s’apprêtent à élire le successeur de Jean Paul II. Quelle que soit l’identité du nouveau pape, il sera confronté à de nombreux défis. Ce sont ces principaux enjeux pour l’avenir du catholicisme que nous abordons dans un dossier spécial. Je ne reviendrai pas sur les analyses et les nombreux points évoqués dans ces pages par Régis Debray, Jean Mouttapa, Henri Tincq, François Thual et Odon Vallet ou sur les propos de divers représentants des autres religions et confessions chrétiennes. J’attirerai juste l’attention sur un aspect. L’un des principaux défis du catholicisme, comme de toute autre religion, c’est la prise en compte de la demande spirituelle de nos contemporains. Or celle-ci s’exprime aujourd’hui de trois manières très peu conformes à la tradition catholique, ce qui rendra extrêmement difficile la tâche des successeurs de Jean Paul II.
On assiste en effet depuis la Renaissance à un double mouvement d’individualisation et de globalisation qui ne cesse de s’accélérer depuis une trentaine d’années. Conséquence sur le plan religieux : les individus tendent à se construire leur spiritualité personnelle en piochant dans le réservoir mondial des symboles, des pratiques et des doctrines. Un Occidental peut aisément aujourd’hui se dire catholique, être touché par la personne de Jésus, aller à la messe de temps en temps, mais aussi pratiquer la méditation zen, croire en la réincarnation et lire des mystiques soufis. Il en va de même pour un Américain du sud, un Asiatique ou un Africain, qui est également, et depuis longtemps, sollicité par un syncrétisme religieux entre catholicisme et religions traditionnelles. Ce « bricolage symbolique », cette pratique du « hors-piste religieux », tend à se généraliser et on voit mal comment l’Eglise catholique pourra imposer à ses fidèles une stricte observance du dogme et de la pratique à laquelle elle est très attachée.
Autre défi colossal : celui du retour de l’irrationnel et de la pensée magique. Le processus de rationalisation, qui est depuis longtemps à l’œuvre en Occident et qui a profondément imprégné le christianisme, fait aujourd’hui apparaître un choc en retour : celui du refoulement de l’imaginaire et de la pensée magique. Or, comme le rappelle ici Régis Debray, plus le monde se technicise et se rationalise, plus il fait apparaître, en compensation, une demande d’affectif, d’émotionnel, d’imaginaire, de mythe. D’où le succès de l’ésotérisme, de l’astrologie, du paranormal et le développement de comportements magiques au sein même des religions historiques – comme le renouveau du culte des saints dans le catholicisme et dans l’islam.
A ces deux tendances, s’ajoute un phénomène qui bouleverse la perspective traditionnelle du catholicisme : nos contemporains se préoccupent bien moins du bonheur dans l’au-delà que du bonheur terrestre. Toute la pastorale chrétienne s’en trouve modifiée : on ne prêche plus le paradis et l’enfer, mais le bonheur de se sentir sauvé dès à présent parce qu’on a rencontré Jésus dans une communion émotionnelle. Des pans entiers du Magistère restent en décalage par rapport à cette évolution qui privilégie le sens et l’affect à la fidèle observance au dogme et à la norme. Pratiques syncrétiques et magiques en vue d’un bonheur sur terre : voilà bien ce qui caractérisait le paganisme de l’Antiquité, héritier des religions de la préhistoire (voir notre dossier), contre lequel l’Eglise a tant lutté pour s’imposer. L’archaïque revient en force dans l’ultramodernité. C’est probablement le plus grand défi qu’aura à relever le christianisme au XXIe siècle. [...]
Le Monde des religions, mars-avril 2005 —
Peu importe que le diable existe ou non. Ce qui est indéniable, c’est qu’il revient. En France et dans le monde. Pas de manière spectaculaire et fracassante, mais de manière diffuse et multiforme. On peut pointer une foule d’indices de ce surprenant come back. Les profanations de cimetières, plus souvent à caractère satanique que raciste, se sont multipliées partout dans le monde au cours de la dernière décennie. En France, ce serait plus de trois mille tombes juives, chrétiennes ou musulmanes qui ont été profanées au cours des cinq dernières années, soit le double qu’au cours de la décennie précédente. Si seulement 18 % des Français croient en l’existence du diable, ce sont les moins de 24 ans qui sont les plus nombreux (27%) à partager cette croyance. Et ils sont 34% à penser qu’un individu peut être possédé par le démon (1). La croyance en l’enfer a même doublé chez les moins de 28 ans au cours des deux dernières décennies (2). Notre enquête montre que des pans non négligeables de la culture ado – gothisme, musique métal – sont imprégnés de référence à Satan, figure rebelle par excellence qui s’est opposé au Père. Faut-il lire dans cet univers morbide et parfois violent la simple manifestation normale d’un besoin de révolte et de provocation ? Ou bien encore se contenter de l’expliquer par la prolifération des films, des BD et des jeux vidéo mettant en scène le diable et ses acolytes ? Dans les années 60 et 70, les ados – et j’en faisais partie – cherchaient davantage à exprimer leur différence et leur révolte par un rejet de la société de consommation. Les gurus indiens et la musique planante des Pink Floyd nous fascinaient davantage que Belzébuth et le heavy metal hyper violent. Ne faut-il pas lire dans cette fascination pour le mal le reflet des violences et des peurs de notre époque, marquée par un délitement des repères et des liens sociaux traditionnels et par une profonde angoisse devant l’avenir ? Comme le rappelle Jean Delumeau, l’histoire montre que ce sont aux périodes de grandes peurs que le diable revient sur scène. N’est-ce pas aussi la raison du retour de Satan en politique ? Réintroduit par l’ayatollah Khomeyni lorsqu’il fustigeait le Grand Satan américain, la référence au diable et la diabolisation explicite de l’adversaire politique a été reprise par Ronald Reagan, Ben Laden et Georges Bush. Ce dernier ne fait d’ailleurs que s’inspirer du regain considérable de popularité dont jouit Satan chez les Evangéliques américains, qui multiplient les pratiques de l’exorcisme et dénoncent un monde soumis aux puissances du Mal. Depuis Paul VI, qui évoquait les « fumées de Satan » pour parler de la sécularisation croissante des pays occidentaux, l’Eglise catholique, qui avait pourtant pris ses distances avec le diable depuis belle lurette, n’est pas en reste et, signe du temps, le Vatican vient de créer un séminaire d’exorcisme au sein de la prestigieuse université pontificale Regina Apostolorum.
Tous ces indices méritaient non seulement un vrai dossier d’enquête sur le retour du diable, mais aussi sur son identité et sur son rôle. Qui est le diable ? Comment est-il apparu dans les religions ? Que disent de lui la Bible et le Coran ? Pourquoi les monothéismes ont-ils davantage besoin de cette figure qui incarne le mal absolu que les religions chamaniques, polythéistes ou asiatiques ? En quoi aussi est-ce que la psychanalyse peut nous éclairer sur ce personnage, sur sa fonction psychique, et permettre une stimulante relecture symbolique du diable biblique ? Car si, selon son étymologie, le « symbole » – sumbolon – est « ce qui réunit », le « diable » – diabolon – c’est « ce qui divise ». Une chose me paraît certaine : ce n’est qu’en identifiant nos peurs et nos « divisions » tant individuelles que collectives, en les mettant au jour par un travail exigeant de conscientisation et de symbolisation, en intégrant notre part d’ombre – comme le rappelle Juliette Binoche dans l’entretien lumineux qu’elle nous a accordé – qu’on viendra à bout du diable et de ce besoin archaïque, aussi vieux que l’humanité, de projeter sur l’autre, sur le différent, sur l’étranger, nos pro¬pres pulsions indomptées et nos angoisses de morcellement.
(1) Selon un sondage Sofres/Pèlerin magazine de décembre 2002.
(2) Les valeurs des Européens, Futuribles, Juillet-Août 2002)
[...]
Le Monde des religions, janvier-février 2005 —
Edito —
Lorsque j’ai commencé à travailler dans l’édition et dans la presse, à la fin des années 80, le religieux n’intéressait personne. Aujourd’hui, à travers des formes multiples, la religion envahit les médias. De fait, leXXIe siècle s’ouvre sur une influence accrue du « fait religieux » dans la marche du monde et des sociétés. Pourquoi ? Nous sommes aujourd’hui confrontés à deux expressions du religieux de nature très différente : le réveil identitaire et le besoin de sens. Le réveil identitaire concerne toute la planète. Il naît de la confrontation des cultures, des nouveaux conflits politiques et économiques qui mobilisent la religion comme emblème identitaire d’un peuple, d’une nation ou d’une civilisation. Le besoin de sens touche avant tout l’Occident sécularisé et désidéologisé. Les individus ultramodernes se méfient des institutions religieuses, ils entendent être les législateurs de leur propre vie, ils ne croient plus aux lendemains radieux promis par la science et le politique : ils continuent néanmoins à être confrontés aux grandes questions de l’origine, de la souffrance, de la mort. De même ont-ils besoin de rites, de mythes et de symboles. Ce besoin de sens réinterroge les grandes traditions philosophiques et religieuses de l’humanité : succès du bouddhisme et de la mystique, renouveau de l’ésotérisme, retour aux sagesses grecques.
Le réveil du religieux sous ses deux versants identitaire et spirituel évoque la double étymologie du mot religion : recueillir et relier. L’être humain est un animal religieux parce qu’il a le regard tourné vers le ciel et questionne l’énigme de l’existence. Il se recueille pour accueillir le sacré. Il l’est aussi parce qu’il cherche à se relier à ses semblables dans un lien sacré fondé sur une transcendance. Cette double dimension verticale et horizontale du religieux existe depuis l’aube des temps. La religion a été l’un des principaux ferments de la naissance et du développement des civilisations. Elle a produit des choses sublimes : la compassion active des saints et des mystiques, les œuvres caritatives, les plus grands chefs-d’œuvre artistiques, de valeurs morales universelles et même la naissance des sciences. Mais dans sa version dure, elle a toujours alimenté et légitimé guerres et massacres. L’extrémisme religieux a lui aussi ses deux versants. Le poison de la dimension verticale, c’est le fanatisme dogmatique ou l’irrationnel délirant. Une sorte de pathologie de la certitude qui peut conduire des individus et des sociétés à tous les extrêmes au nom d’une foi. Le poison de la dimension horizontale, c’est le communautarisme raciste, une pathologie de l’identité collective. Le mélange explosif des deux a donné les chasses aux sorcières, l’Inquisition, l’assassinat d’Itzhak Rabin et le 11 septembre.
Face aux menaces qu’elles font peser sur la planète, certains observateurs ou intellectuels européens sont tentés de réduire la religion à ses formes extrémistes et à la condamner en bloc (par exemple islam = islamisme radical). C’est une grave erreur qui a pour effet d’amplifier ce qu’on entend combattre. On ne parviendra à vaincre l’extrémisme religieux qu’en reconnaissant aussi la valeur positive et civilisatrice des religions et en acceptant leur diversité ; en admettant que l’homme a besoin individuellement et collectivement de sacré et de symboles ; en s’attaquant à la racine des maux qui expliquent le succès de l’instrumentalisation actuelle du religieux par le politique : inégalités Nord-Sud, pauvreté et injustice, nouvel impérialisme américain, mondialisation trop rapide, mépris pour les identités et les coutumes traditionnelles… Le XXIe siècle sera ce que nous en ferons. Le religieux pourra y être tout autant un outil symbolique mis au service de politiques de conquête et de destruction qu’un ferment d’épanouissement individuel et de paix mondiale dans la diversité des cultures. [...]
Le Monde des Religions, novembre-décembre 2004 —
Edito —
Nous assistons depuis quelques années à un retour des certitudes religieuses, lié à une crispation identitaire, qui focalise l’attention des médias. Je crois que c’est l’arbre qui cache la forêt. Pour ce qui concerne l’Occident, ne perdons pas de vue le chemin parcouru en un siècle. Le dossier que nous consacrons au centenaire de la loi française de séparation des Eglises et de l’Etat m’a donné l’occasion de replonger dans cet incroyable contexte de haine et d’exclusion mutuelle qui prévalait alors entre le camp des papistes et celui des anticléricaux. En Europe, le tournant du XIXe et du XXe siècles était celui des certitudes. Certitudes idéologiques, religieuses, scientistes. De nombreux chrétiens étaient persuadés que les enfants non baptisés iraient en enfer et que seule leur Eglise possédait la vérité. Les athées, quant à eux, méprisaient la religion et la considéraient comme une aliénation anthropologique (Feuerbach), intellectuelle (Comte), économique (Marx) ou psychologique (Freud).
Aujourd’hui, en Europe et aux Etats-Unis, 90% des croyants estiment, selon une enquête récente, qu’aucune religion ne détient à elle seule la Vérité, mais qu’il y a des vérités dans toutes les religions. Les athées, aussi, sont plus tolérants, et la plupart des scientifiques ne considèrent plus la religion comme une superstition appelée à disparaître avec les progrès de la science. Globalement, d’un univers clos de certitudes on est passé, en à peine un siècle, à un monde ouvert de probabilités. Cette forme moderne de scepticisme, dont François Furet disait qu’il était « l’horizon indépassable de la modernité », a pu se généraliser dans nos sociétés parce que les croyants se sont ouverts aux autres religions, mais aussi parce que la modernité s’est débarrassée de ses certitudes héritées du mythe scientiste du progrès: là où la connaissance avance, la religion et les valeurs traditionnelles reculent.
Ne sommes-nous pas dès lors devenus des disciples de Montaigne? Quelles que soient leurs convictions philosophiques ou religieuses, une majorité d’Occidentaux souscrivent en effet au postulat selon lequel l’intelligence humaine est dans l’incapacité d’atteindre des vérités ultimes et des certitudes métaphysiques définitives. Autrement dit, Dieu est incertain. Comme l’expliquait déjà il y a cinq siècles notre grand philosophe, on ne peut donc croire, mais aussi ne pas croire, que dans l’incertitude. L’incertitude, dois-je le préciser, ne signifie pas le doute. On peut avoir la foi, des intimes convictions, des évidences, mais admettre que d’autres puissent, de bonne foi et avec autant de bonnes raisons que nous, ne pas les partager. Les entretiens accordés au Monde des Religions par deux hommes de théâtre, Eric-Emmanuel Schmitt et Peter Brook, sont à cet égard éloquents. Le premier croit avec ferveur en « un Dieu non identifiable » qui ne « vient pas d’un savoir » et affirme qu’« une pensée qui ne doute pas d’elle-même n’est pas intelligente ». Le second ne fait aucune référence à Dieu, mais reste ouvert à un divin « inconnu, innommable » et confesse: « J’aurais aimé dire: “Je ne crois en rien…” Mais croire en rien, c’est encore l’expression absolue d’une croyance. » De tels propos illustrent ce fait, qui mériterait à mon avis d’être davantage médité pour sortir des stéréotypes et des discours simplificateurs: le vrai clivage aujourd’hui est de moins en moins, comme au siècle dernier, entre les « croyants » et les « incroyants », mais entre ceux, « croyants » ou « incroyants », qui acceptent l’incertitude et ceux qui la refusent. ?
Le Monde des Religions, novembre-décembre 2004 [...]
Enregistrer